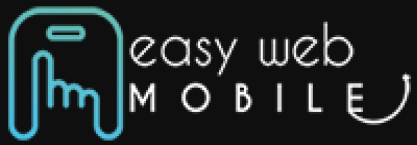« Una llengua sense fronteres » : 238 mairies approuvent les motions en faveur de l’officialisation du catalan dans l’UE et des liens entre la Catalogne Nord et Sud
La campagne "Una llengua sense frontera" menée actuellement par les Angelets de la Terra a permis de proposer aux mairies de l’ensemble de la Catalogne des motions en faveur de la reconnaissance officielle du catalan au sein de l’Union européenne, ainsi que de l’affirmation de la solidarité entre les Catalans du Nord.
Cette campagne a pour objectif d’affirmer la langue catalane commune, mais aussi de rappeler les liens naturels et historiques qui unissent les Catalans, malgré la frontière issue du Traité des Pyrénées de 1659.
Il s’agit d’une démarche unitaire et transversale, permettant de dépasser les clivages politiques. Les élus municipaux se sont rassemblés autour d’objectifs partagés : la sauvegarde de la langue catalane et le renforcement des liens entre Catalans au-delà de la frontière. De nombreux conseils municipaux ont adopté ces motions à l’unanimité, réunissant majorités et oppositions autour d’une cause commune.
Cette campagne s’inscrit dans la continuité des Trobades sense Fronteres de Municipis Catalans et du Livre Blanc de Catalogne Nord, organisés par les Angelets de la Terra, ainsi que des manifestations, festivals et expositions menés en collaboration avec les municipalités à la suite du 1er octobre 2017.
L’objectif des motions votées en conseil municipal est de rappeler que l’unité culturelle et linguistique demeure un outil essentiel de cohésion et de développement face aux défis à venir.
«Les frontières sont les cicatrices de l’histoire, et les Angelets de la Terra œuvrent pour soigner les traumatismes qu’elles ont engendrées. Nous avons imaginé la campagne “Une langue sans frontières” parce que le catalan est un outil puissant pour recoudre les blessures et réunir à nouveau le peuple que la frontière a séparé», Ramon Faura, président des Angelets de la Terra.
1 – Motions des mairies de Catalogne Nord pour la reconnaissance officielle du catalan par l’Union européenne
En Catalogne Nord, l’année 2025 a été marquée par une mobilisation institutionnelle sans précédent. Sous l’impulsion des Angelets de la Terra, de nombreuses communes nord-catalanes ont adopté une motion de soutien à la reconnaissance du catalan comme langue officielle de l’Union européenne. Cette campagne qui a débuté en juin 2025 est toujours en cours.
Les communautés de communes Roussillon-Conflent, Aspres et Pyrénées Catalanes ont ouvert la voie en approuvant à l’unanimité la motion proposée par les Angelets de la Terra.
Cette motion appelle le gouvernement français à soutenir la reconnaissance officielle du catalan au niveau européen. Elle rappelle que cette langue est parlée par plus de 10 millions de personnes en Europe, qu’elle est langue officielle en Andorre, officielle dans plusieurs territoires de l’État espagnol, et reconnue par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
Elle souligne également que le gouvernement espagnol a formellement demandé à l’Union européenne d’accorder un statut officiel au catalan, une démarche qui contribuerait au renforcement de la diversité culturelle européenne et à la reconnaissance de la dignité des locuteurs catalanophones.
2- Motions des mairies de Catalogne Sud en soutien aux mairies de Catalogne Nord
À la fin de l’été 2025, les Angelets de la Terra ont élargi leur campagne de motions aux municipalités de Catalogne Sud, afin de donner continuité et résonance à la mobilisation engagée au nord.
L’objectif est de partager la lutte pour la langue commune, renforcer les liens dans une Europe sans frontières.
La motion de soutien, approuvée par de nombreuses municipalités sud-catalanes, exprime la solidarité envers les Catalans du nord dans leur appel au gouvernement français pour qu’il défende la reconnaissance du catalan comme langue officielle de l’Union européenne.
Elle manifeste aussi la gratitude des citoyens du sud envers la Catalogne Nord, qui avait montré un large soutien populaire et institutionnel en réponse à la répression qui suivit le référendum du 1er octobre 2017.
Liste des mairies de Catalogne qui ont voté cette motion :
Alt Camp
Alió
Montferri
Riba (La)
Rodonyà
Rourell (El)
Alt Penedès
Granada (La)
Alta Cerdanya
Bolquera
Èguet
Eina
Er
Estavar
Font-romeu, Odelló i Vià
Guingueta d’Ix (La)
Naüja
Vallcebollera
Alta Ribagorça
Vall de Boí
Alta Segarra
Sanaüja
Alt Empordà
Bàscara
Biure
Cabanelles
Cadaqués
Cantallops
Darnius
Espolla
Figueres
L'Armentera
Lladó
Llançà
Navata
Palau de Santa Eulàlia
Port de la Selva
Sant Miquel de Fluvià
Sant Climent Sescebes
Sant Pere Pescador
Saus, Camallera i Llampaies
Vila-sacra
Vilabertran
Alt Urgell
Organyà
Ribera de l'Urgellet
Anoia
Bruc (El)
Copons
Òdena
Baix Camp
Borges del Camp
Vinyols i els Arcs
Baix Ebre
Aldea (L’)
Ametlla de Mar
Roquetes
Baix Empordà
Begur
Bellcaire d’Empordà
Colomers
Tallada d'Empordà
Vall-Llobrega
Baix Montseny
Sant Antoni de Vilamajor
Baix Penedès
Banyeres del Penedès
Sant Jaume dels Domenys
Baixa Cerdanya
Alp
Das
Fontanals de Cerdanya
Lles de Cerdanya
Montellà i Martinet
Prats i Sansor
Puigcerdà
Bages
Aguilar de Segarra
Calders
Manresa
Mura
Rajadell
Berguedà
Berga
Borredà
Guardiola de Berguedà
Olvan
Pobla de Lillet
Puig-reig
Gósol
Capcir
Angles (Els)
Formiguera
Font-rabiosa
Matamala
Puigbalador
Real
Conflent
Aiguatèbia i Talau
Cabanassa (La)
Castell
Caudiers de Conflent
Censà
Cornellà de Conflent
Eus
Finestret
Fontpedrosa
Glorianes
Llaguna (La)
Mont-Louis
Nyer
Oleta i Èvol
Orellà
Pi
Planès
Ralleu
Rià i Cirac
Rodès
Sant Pere dels Forcats
Sautó
Vallestàvia
Vernet
Vilafranca de Conflent
Fenolleda
Bellestar
Montalbà
Garrigues
Cogul (El)
Garrotxa
Argelaguer
Sant Jaume de Llierca
Tortellà
Gironès
Bescanó
Bordils
Campllong
Canet d'Adri
Juià
Sant Gregori
Sant Julià de Ramis i Medinyà
Lluçanès
Sant Martí d'Albars
Maresme
Canet de Mar
Sant Cebrià de Vallalta
Moianès
Castellcir
Santa Maria d’Oló
Noguera
Àger
Bellcaire d’Urgell
Les Avellanes i Santa Linya
Osona
Balenyà
Espinelves
Manlleu
Montesquiu
Sant Julià de Vilatorta
Sant Vicenç de Torelló
Santa Maria de Besora
Seva
Sora
Tavertet
Vic
Viladrau
Pallars Jussà
Salàs de Pallars
Pallars Sobirà
Esterri de Cardós
Pla de l'Estany
Sant Miquel de Campmajor
Vilademuls
Pla d'Urgell
Fondarella
Palau d'Anglesola
Vilanova de Bellpuig
Ripollès
Campdevànol
Planoles
Queralbs
Sant Joan de les Abadesses
Ribera d’Ebre
Ascó
Móra d'Ebre
Palma d'Ebre
Terra Alta
Prat de Comte
Rosselló
Alenyà
Argelers
Bages
Banyuls dels Aspres
Barcarès (El)
Brullà
Bula d’Amunt
Bulaternera
Calmelles
Cameles
Cànoes
Casafabra
Cases de Pena
Castellnou dels Aspres
Cervera de la Marenda
Clairà
Corbera
Corbera-les-Cabanes
Cornellà de la Ribera
Cornellà del Bercol
Espirà de l'Aglí
Estagell
Forques
Illa
Llauró
Millars
Montoriol
Nefiac
Oms
Òpol i Perellós
Paçà
Palau-del-Vidre
Pesillà de la Ribera
Portvendres
Prunet i Bellpuig
Queixàs
Salelles
Salses
Sant Andreu
Sant Cebrià de Rosselló
Sant Feliu d'Amunt
Sant Feliu d'Avall
Sant Genís de Fontanes
Sant Joan la Cella
Sant Marçal
Sant Miquel de Llotes
Sant Nazari de Rosselló
Santa Coloma de Tuïr
Soler (El)
Sureda
Talteüll
Terrats
Toluges
Torderes
Torre del Bisbe
Trasserra
Trullars
Tuïr
Vilamulaca
Segrià
Massalcoreig
Vilanova de la Barca
Selva (La)
Arbúcies
Osor
Riells i Viabrea
Sant Hilari Sacalm
Sant Julià del Llor i Bonmatí
Santa Coloma de Farners
Sils
Susqueda
Vilobí, Salitja i Sant Dalmai
Solsonès
Lladurs
Llobera
Pinell de Solsonès
Sant Llorenç de Morunys
Urgell
Fuliola (La)
Preixana
Vilagrassa
Vallès Occidental
Rellinars
Vallès Oriental
Cardedeu
Garriga (La)
Santa Maria de Palautordera
Vallespir
Arles
Banys i Paladà
Costoja
Ceret
Morellàs i les Illes
Sant Joan de Pladecorts
Tec (El)
Cette campagne conjointe entre le nord et le sud constitue bien plus qu’un geste symbolique : c’est un acte de fraternité et de cohérence historique. Elle rappelle que la langue catalane unit ceux que la frontière sépare, et qu’en l’affirmant comme langue de coopération et de développement, les municipalités catalanes posent les bases d’un avenir partagé, plus fort et plus positif.
La campagne de motions n’est pas terminée. Pour recevoir le modèle de motion et pouvoir la voter en conseil municipal contactez-nous à info@angeletsdelaterra.com
Livre blanc sur l’enseignement du catalan en Catalogne Nord, avec pour horizon un territoire pleinement bilingue
La publication du Livre blanc de l’enseignement du catalan par l’association Angelets de la Terra représente un tournant dans la réflexion collective sur l’avenir de la langue catalane dans le département des Pyrénées-Orientales. Ce document, conçu comme un outil de diagnostic et d’action, répond à un double besoin : d’une part, mettre en évidence la précarité de la situation actuelle de l’enseignement du catalan ; d’autre part, offrir aux responsables politiques et aux acteurs éducatifs un ensemble de propositions concrètes permettant un changement de paradigme. Le texte a été très bien accueilli par les élus locaux, qui y ont reconnu à la fois le sérieux du diagnostic et l’urgence de rattraper un retard qui place la Catalogne Nord bien derrière d’autres territoires de France où les langues régionales ont connu un développement significatif dans le système public.
Ce Livre blanc est la continuation logique d’un processus commencé en 2021 avec la première édition du Livre blanc de Catalogne Nord, qui regroupait 55 communes, puis renforcé en 2022 avec une deuxième édition rassemblant 115 municipalités sur les 198 communes catalanes du département. Ces deux documents abordaient la politique culturelle catalane dans son ensemble, en proposant 55 mesures que les municipalités pouvaient mettre en œuvre en faveur de la langue, de la culture, du patrimoine et de la coopération transfrontalière. Le Livre blanc de l’enseignement du catalan de 2025 est également la continuité du mouvement institutionnel généré par les motions en faveur de la reconnaissance officielle du catalan dans l’Union européenne et par la demande adressée au gouvernement français de la soutenir, motions rédigées par les Angelets de la Terra et approuvées par de nombreuses municipalités de Catalogne Nord. Avec cette nouvelle publication, les Angelets approfondissent un domaine fondamental jusqu’ici peu structuré : la transmission scolaire du catalan, élément clé pour assurer la vitalité et l’avenir de la langue dans notre territoire.
Un diagnostic alarmant : une offre éducative insuffisante et dépassée
Le point de départ du Livre blanc est un diagnostic clair et documenté : l’enseignement du catalan en Catalogne Nord ne répond pas aux demandes de la population et ne respecte pas les standards de développement observés dans d’autres régions de France disposant d’une langue propre. Ce retard est particulièrement visible lorsqu’on le compare à des situations comme celles du Pays basque ou de la Corse, où les politiques linguistiques ont fait des progrès notables grâce à un engagement ferme en faveur du modèle bilingue.
Selon les données du Conseil académique des langues régionales pour l’année scolaire 2024-2025 :• Seuls 6 % des élèves du département suivent un parcours bilingue ou immersif.• Moins de 1 % des lycéens poursuivent un enseignement bilingue.• Il n’existe aucun lycée avec une filière immersive, après que le projet de centre immersif à Perpignan a été bloqué par la municipalité.
Ces chiffres placent la Catalogne Nord en queue de classement national en matière d’enseignement des langues régionales. À l’inverse, au Pays basque, plus de la moitié des élèves suivent un enseignement bilingue ou immersif, grâce à une structure consolidée et à un large consensus institutionnel. En Corse, le Pianu Lingua 2020-2030 vise la généralisation progressive du bilinguisme dans le système public, et le nombre de sections bilingues a déjà augmenté de manière significative.
Le contraste est flagrant : tandis que d’autres territoires dotés de langues propres ont pris des décisions politiques structurelles et fourni aux établissements scolaires les moyens nécessaires, la Catalogne Nord reste dépendante d’initiatives fragmentées et d’une volonté institutionnelle insuffisante.
Un décalage injustifiable face à une forte demande populaire
L’un des points centraux du Livre blanc est l’affirmation que le problème ne provient pas d’un manque de soutien social. Dès 2015, une enquête montrait que 76 % de la population des Pyrénées-Orientales était favorable à l’enseignement systématique du catalan à l’école. Cette tendance ne s’est pas affaiblie : les familles souhaitent toujours un enseignement bilingue qui offre à leurs enfants des compétences linguistiques adaptées à un territoire naturellement bilingue et à un espace économique transfrontalier où le catalan constitue un atout.
La contradiction entre demande et offre est donc profonde : tandis que la population réclame davantage de catalan à l’école, l’administration éducative maintient un modèle qui limite drastiquement l’accès à un apprentissage de qualité. Beaucoup de familles se retrouvent ainsi contraintes de se déplacer vers d’autres communes, voire d’inscrire leurs enfants dans des écoles immersives privées où l’usage social et scolaire du catalan est plus intensif, comme les écoles de la Bressola. Ce phénomène, générateur d’inégalités d’accès, révèle l’absence d’un modèle public structuré.
Les fondements juridiques existent : seule manque la volonté politique
Le Livre blanc souligne que le cadre juridique français n’empêche pas le développement de l’enseignement bilingue. Au contraire :• La loi Molac (2021) garantit le droit des élèves à apprendre une langue régionale.• La circulaire de 2017 définit le modèle de parité horaire pour les sections bilingues.• La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, bien que partiellement ratifiée par la France, reconnaît la nécessité de protéger et de promouvoir ces langues.
Le problème n’est donc pas d’ordre légal, mais relève des décisions administratives et politiques. Les territoires qui ont progressé l’ont fait grâce à des engagements forts entre collectivités territoriales, départements, régions et académies. La Catalogne Nord a besoin de cette même coordination et de cette même volonté.
L’objectif : un territoire bilingue en 2040
Le Livre blanc propose un horizon ambitieux mais réaliste : faire de la Catalogne Nord un territoire pleinement bilingue d’ici 2040. Cet objectif repose sur trois piliers principaux :
4.1. Généralisation des sections bilingues dans toutes les écoles
Il s’agit que, dans un délai raisonnable, toutes les communes du département disposent d’au moins une filière bilingue publique à parité horaire. Ce modèle, expérimenté en Bretagne, en Occitanie, en Corse et au Pays basque, a démontré sa solidité pédagogique et son efficacité sociale.
4.2. Continuité éducative jusqu’au baccalauréat
Beaucoup d’élèves qui commencent le bilinguisme en maternelle ne peuvent pas le poursuivre au collège ou au lycée, faute d’offre. Le Livre blanc demande une véritable continuité jusqu’à la fin du secondaire, condition indispensable pour former des citoyens réellement bilingues.
4.3. Création de centres ou de filières immersives
Là où la demande est majoritaire, la création de filières immersives publiques est proposée, spécialement dans les zones urbaines à population diverse. Ce modèle a produit d'excellents résultats académiques dans d’autres territoires.
Le rôle essentiel des municipalités
Les Angelets de la Terra insistent sur le rôle déterminant des communes, qui sont les seules habilitées à demander l’ouverture de sections bilingues. Le Livre blanc clarifie un point souvent méconnu : une filière bilingue ne génère aucun coût direct pour la municipalité, car :• les enseignants sont fournis et rémunérés par l’Éducation nationale,• le matériel pédagogique de base est également pris en charge,• et le fonctionnement ordinaire de l’école reste inchangé.
De plus, lorsqu’une école du village ne propose pas d’enseignement bilingue et que les familles scolarisent leurs enfants dans une commune voisine qui en dispose, la municipalité dépourvue d’offre doit payer le forfait scolaire. D’un point de vue économique, pédagogique et territorial, l’ouverture d’une section bilingue constitue donc une décision bénéfique.
Le Livre blanc propose aux communes :• la procédure administrative complète pour demander une filière bilingue,• des modèles de courriers,• des recommandations de communication à destination des familles,• et des informations statistiques pour appuyer la demande.
Ce document s’inscrit dans la continuité de la motion présentée en juin 2025 pour la reconnaissance du catalan comme langue officielle de l’Union européenne, approuvée par près de la moitié des municipalités du département. L’engagement linguistique municipal fait ainsi partie d’une dynamique plus large.
Les bénéfices du bilinguisme : un investissement pour l’avenir
Le Livre blanc compile de nombreuses études démontrant les avantages du bilinguisme dans plusieurs domaines.
6.1. Bénéfices cognitifs
Les enfants bilingues développent davantage :• l’attention sélective,• la mémoire de travail,• la flexibilité cognitive,• la capacité de résolution de problèmes.
Ces bénéfices ne sont pas propres au catalan, mais inhérents au bilinguisme.
6.2. Bénéfices culturels et sociaux
Le bilinguisme renforce le sentiment d’appartenance au territoire tout en facilitant l’intégration des familles nouvellement arrivées, qui découvrent une langue et une culture locales ouvertes et inclusives.
6.3. Bénéfices économiques
La Catalogne Nord se situe au cœur d’un espace économique transfrontalier dynamique : Gérone, Figueres et Barcelone sont des pôles d’activité majeurs. Le catalan constitue un atout professionnel réel dans des secteurs tels que le commerce, le tourisme, les transports, la recherche médicale, la culture ou les technologies.
Un outil de travail pour les élus, les familles et les établissements
Le Livre blanc n’est pas seulement un diagnostic ; c’est surtout un instrument pratique destiné à tous les acteurs concernés. Il inclut :• un guide pas à pas pour ouvrir une section bilingue,• un rappel des textes légaux en vigueur,• une synthèse des recherches pédagogiques sur le bilinguisme,• des données détaillées par commune,• des recommandations sur la présentation du projet aux familles,• et une explication claire du fonctionnement de la parité horaire.
Cette dimension pratique explique en grande partie pourquoi le document a été largement salué par les élus du département.
Le catalan : une langue européenne à défendre
Le Livre blanc place la situation nord-catalane dans une perspective européenne. Le catalan est une langue officielle ou coofficielle dans plusieurs territoires et fait partie de la diversité linguistique reconnue en Europe. Son enseignement en Catalogne Nord contribue à :• renforcer la cohésion culturelle entre les deux versants des Pyrénées,• préserver un patrimoine européen,• et faciliter la coopération économique transfrontalière.
Promouvoir l’enseignement du catalan en France revient, d’une certaine manière, à contribuer à la pluralité culturelle de l’Europe.
Une opportunité historique pour transformer l’avenir de la langue catalane en Catalogne Nord
La Catalogne Nord se trouve face à une opportunité exceptionnelle pour avancer vers un modèle éducatif moderne, bilingue et inclusif. Le Livre blanc de l’enseignement du catalan offre les outils nécessaires pour transformer un diagnostic préoccupant en action collective. L’avenir de la langue catalane ne dépend pas uniquement des institutions ou de l’administration : il est d’abord éducatif.
L’ambition d’atteindre en 2040 un territoire pleinement bilingue est tout à fait réaliste si la volonté politique, l’engagement municipal et la mobilisation de la communauté éducative sont au rendez-vous. Le Livre blanc démontre que ce chemin est possible, nécessaire et urgent. Il nous faut former des enseignants et demander aux chefs d’établissement de placer le catalan au cœur du projet éducatif. Jusqu’à présent, la langue a souvent été reléguée à un rôle secondaire ; il est temps d’en faire un élément structurant de l’enseignement et du territoire.
Centre Culturel de Catalogne Nord à Ribesaltes - Musée Faura : un projet fédérateur, lieu de création et de rencontres
à
- Ribesaltes ROSSELLÓ
Un projet fédérateur, lieu de créations et de rencontres, ouvert à tous.
Depuis octobre 2025, au nord de Perpignan, un projet de centre culturel catalan ambitieux et fédérateur à vu le jour à Rivesaltes dans un grand mas, à proximité de la sortie n°41 de l'autoroute et de l'aéroport. À l’initiative de la famille FAURA et de l’association Angelets de la Terra, ce lieu incarne une catalanité vivante, ouverte et moderne. Il s’agit d’un espace partagé, dédié à l’exposition permanente des œuvres de l’artiste peintre Ramon FURA-LLAVARI (1945-2022) et aux projets d’associations, artistes et citoyens désireux de faire vivre une culture catalane ouverte sur le monde.
Ce centre culturel, pensé comme un village, sera un lieu unique, une pépinière d’initiatives, où toutes les bonnes volontés pourront développer des projets en lien avec la catalanité : culture, langue, arts, musique, théâtre, patrimoine, gastronomie,... Un programme d’activités sera édité tous les six mois, mêlant convivialité, festivités et réflexions. Les visiteurs pourront aussi venir simplement profiter de la grande cour intérieure, lire un livre à l’ombre des platanes majestueux, écouter de la musique… comme sur la place d'un village qui a conservé son âme.
Un centre ouvert, indépendant et collaboratif
Le Centre Culturel de Rivesaltes offrira un cadre idéal pour le développement de projets culturels, artistiques et associatifs. Pensé comme un outil au service du territoire et de ses habitants, il permettra à toutes les structures souhaitant y œuvrer pour la catalanité d’agir en toute indépendance, tout en bénéficiant d’un accompagnement logistique de qualité : mise à disposition de locaux et des équipements, soutien à la communication, coordination globale par les Angelets de la Terra,...
Ce centre ne sera pas un organisateur de spectacles en tant que tel, mais il accueillera celles et ceux qui souhaitent y créer des événements, en leur proposant un espace adapté, un accompagnement sur mesure et en leur demandant une participation, en fonction des moyens de chacun.
Une catalanité moderne, inclusive et connectée
Depuis plus de 25 ans, les Angelets de la Terra œuvrent pour la diffusion de la culture catalane avec des actions marquantes : penya de l’USAP, revue bilingue, festivals, hommages à Joan Pau Giné, expositions photo, mobilisations pour les prisonniers politiques catalans, édition du Llibre Blanc de Catalunya Nord auquel ont participé 60% des mairies, rencontres biannuelles entre les mairies de Catalogne Nord et Sud, ou encore la coordination d’un collectif de plus de 100 musiciens nord-catalans chantant en catalan.
Le centre de Ribesaltes sera le prolongement de la dynamique générée par les Angelets de la Terra, avec pour objectif de :
Renforcer les liens entre Catalans au nord et au sud des Pyrénées
Valoriser l’histoire et les traditions catalanes
Encourager la création artistique en catalan
Mettre en avant d’autres cultures minorisées ou nations sans État (Bretons, Occitans, Kabyles, Mapuches, Tibétains…)
Une programmation annuelle riche et accessible à tous
Le centre s’articulera autour de quatre axes majeurs :
Valoriser l’œuvre du peintre Ramon Faura-Llavari (1945-2022)
Une exposition permanente sera installée dans un espace muséal dédié. Cet artiste, ayant vécu à Barcelone, Perpignan, Tautavel et Saint-Cyprien, a exposé dans toute l’Europe, vendu plus d’un millier de toiles et exposé notamment avec Salvador Dalí. Son œuvre est la raison d’être du centre culturel et servira de fil rouge au projet.
Proposer une programmation culturelle variée
Musique, théâtre, danse, arts visuels, cinéma, littérature... Le centre sera un lieu vivant où se dérouleront spectacles, expositions, conférences, ateliers, projections et résidences d’artistes. Le centre proposera aussi un studio d’enregistrement, des scènes ouvertes, un espace de projection, et des résidences de musiciens et artistes de tous les Pays Catalans.
Partager les lieux avec associations, commerçants, professionnels et citoyens
Un espace de coworking sera ouvert aux associations locales, artistes, étudiants, indépendants, commerçants du territoire,… Les salles du centre pourront être utilisées par diverses structures pour des réunions, événements ou ateliers. La cours intérieure pourra être utilisé pour y organiser des représentations, des marchés de producteurs,… Le projet du centre culturel sera amené à être en perpétuelle construction, en fonction des propositions et des rencontres.
Créer des échanges culturels avec les Pays Catalans et au-delà
Grâce au réseau développé par les Angelets de la Terra depuis 2001, le centre sera un carrefour culturel entre Catalogne Nord et Sud, mais aussi un point de rencontre et d’échanges avec d’autres cultures minorisées et nations sans État.
Des infrastructures polyvalentes
Avec plus de 1100 m² de bâtiments et environ d’1,5 hectare de terrain, le Centre Culturel à pour objectif d’offrir avec la participation d’acteurs locaux:
Un musée (Museu Faura) et des espaces d’exposition permanente et temporaire
Une salle polyvalente de 248 m² pour concerts, spectacles, projections, etc.
Un espace coworking et bibliothèque, avec de la documentation en catalan et français
Des ateliers pour les arts plastiques, la danse, la musique et le théâtre
Des cours de catalan
Un espace Penyes USAP / Dragons / Barça pour la retransmission des matchs
Un jardin partagé, un espace enfants, une scène extérieure et un coin lecture
Des salles de conférences, espace multimédia et des outils technologiques
Des équipements adaptés PMR
Etc...
classe de catalan, de danses traditionnelles, création musicale en catalan, exposition temporaires, radio et télé en catalan sur Internet, espace de travail et de réunions partagés, jardin botanique et jardin partagé, fabrication de l'huile d'olive du mas, marché de producteurs locaux, librairie et maison d'édition, création de la fédération des associations catalanes dans le mas, correfoc, castellers, penyes de l'USAP, des Dragons Catalans, du FC Barcelona et des clubs sportifs catalans en général, mise en avant des autres cultures de nations sans état comme les occitans, les bretons, les kabyles, les mapuches, les tibétains...
Un centre qui place la convivialité au cœur de son projet
Le centre mettra un point d’honneur à accueillir toutes les générations : enfants, familles, seniors, catalans d’origine ou « nouveaux catalans », catalanophones ou personnes ne sachant pas parler catalan. Il sera un lieu de transmission et d’échange intergénérationnel, où chacun pourra trouver sa place.
Les principes fondateurs du projet :
Ouverture, inclusion et respect de la diversité
Partage, coopération et intelligence collective
Tradition et innovation
Écologie et durabilité
Neutralité, laïcité et solidarité
Fête et convivialité
Un incubateur d’idées innovantes pour dynamiser la catalanité
Ce centre culturel se veut bien plus qu’un simple lieu associatif ou un musée. C’est un projet de société, un foyer d’énergies créatives, et un moteur pour la catalanité du XXIe siècle. Que vous soyez artiste, bénévole, enseignant, chef d’entreprise, artisan, ou simplement curieux : ce centre a besoin de vous pour grandir.
Rejoignez-nous pour faire vivre, transmettre et réinventer la culture catalane !
Rencontres sans frontières des municipalités catalanes : renforcer les liens pour retrouver l’unité d’un peuple
✔ 15 comarques: Alt Empordà, Baix Empordà, Capcir, Cerdanya, Conflent, Garrotxa, Lluçanès, Maresme, Pla de l'Estany, Rosselló, Selva, Urgell, Vallespir, Vallès Oriental, Gironès✔ 75 mairies participent à ces Trobades sense fronteres: 40 mairies ont confirmé leur présence à la quatrième rencontre. Soyez parmi eux !✔ 37 mairies de Catalogne Sud: Arbúcies, Argelaguer, Bàscara, Bordils, Campllong, Campdevànol, Cabanelles, Cabanes, Canet de Mar, Cantallops, Capmany, Castelló d'Empúries, Cornellà del Terri, Darnius, Espolla, La Fuliola, Gombrèn, Les Preses, Lladó, Llançà, Malla, Manlleu, Mieres, Montesquiu, Olot, Ordis, Osor, Riudaura, Riudellots de la Selva, Roses, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Climent Sescebes, Sant Hilari Sacalm, Sant Julià de Ramis, Sant Martí d'Albars, Sant Quirze de Besora,Santa Coloma de Farners, Sarrià de Ter, Torroella de Fluvià, Verges, Vilablareix.✔ 38 mairies de Catalogne Nord: Alenyà, Argelers, Cases de Pena, Cànoes, Ceret, Cervera de la Marenda, Clairà, Corbera, Cornellà del Bercol, Èguet, Espirà de l'Aglí, Estavar, Eus, Finestret, Fontpedrosa, Font-rabiosa, La Guingueta d'Ix, La Menera, Morellàs i les Illes, Òpol i Perellós, Palau-del-Vidre, Perpinyà, Pesillà de la Ribera, Portvendres, Reiners, Sant Andreu de Sureda, Sant Cebrià de Rosselló, Sant Feliu d'Amunt, Sant Feliu d'Avall, Sant Genís de Fontanes, Sant Llorenç de la Salanca, Sant Nazari de Rosselló, El Soler, Sureda, Toluges, La Torre del Bisbe, Tuïr, Vilafranca de Conflent.✔ 1 Communauté de communes: Pyrénées Catalanes (Capcir-Alta Cerdagne)
Les "Trobades sense Fronteres dels Municipis Catalans" sont des rencontres organisées entre des municipalités catalanes de part et d'autre des Pyrénées, impliquant des villages du Principat de Catalogne et de la Catalogne Nord. L'objectif de ces rencontres est de "supprimer les frontières mentales" et de travailler sur des projets communs pour établir une relation fluide entre les catalans du Nord et du Sud. Ces événements visent à rétablir les liens culturels et linguistiques entre les communautés catalanes des deux côtés de la frontière franco-espagnole.
Les Angelets de la Terra sont une association culturelle, créée en 2001 à Perpignan, qui promeut la langue et les liens avec le reste du pays. Au départ, elle était un club de supporters de l’USAP, puis un collectif de musiciens avec 275 chansons enregistrées en catalan et maintenant un collectif de communes."Nous pensons que cela nous aidera à renforcer les liens et à effacer une frontière mentale qui bloque les dynamiques communes. Si nous voulons normaliser des relations qui devraient être naturelles, comme elles l’ont été pendant des siècles, nous devons organiser des rencontres catalano-catalanes pas franco-espagnoles", expliquent les Angelets de la Terra.
Les maires et conseillers présents ont signé une charte commune, exprimant la volonté de renforcer les liens et de poursuivre ces rencontres. Ce document incite les mairies à désigner une personne chargée de développer les échanges entre le nord et le sud, d’inviter des élus des communes amies lors des célébrations officielles, d’organiser des sorties pour renforcer les liens et de promouvoir la langue, la culture, l’histoire et l’identité communes avec des projets visant à effacer la frontière mentale.
Pour amorcer les échanges, des speed meetings organisés lors de chaque Trobada permettent à chaque mairie de créer des liens avec trois autres mairies de l’autre côté de la frontière. Les représentants des communes participent également à des tables rondes sur différents thèmes : économie, échanges culturels, enseignement de la langue catalane et histoire commune. L’objectif est de débattre et de définir les besoins, les outils et le rôle de chaque commune pour développer des projets d’intérêt commun dépassant les jumelages classiques.
Des représentations musicales en catalan des musiciens du collectifs des Angelets de la Terra animent chaque Trobada avec des chanteurs comme Joan Ortiz, Maxime Cayuela, qui a conquis toute la Catalogne avec son interprétation de Tant com me quedarà dans The Voice kids, ainsi que Julien Leone, qui a triomphé dans l’émission Eufòria sur TV3 et le groupe Llamp te frigui.
Programmes des Rencontres sans frontières des municipalités catalanes
10h00 > Petit-déjeuner / signature de la charte / accréditations / début des entretiens de tous les participants (vidéos)
Musique avec le Collectif Angelets de la Terra
Photo de groupe avec tous les participants et organisateurs
10h40 > Discours de bienvenue du maire de Campllong et des Angelets de la Terra
Durée : 15 minutes
11h00 > Tour de table pour expliquer les échanges réalisés depuis la première Rencontre sans frontières
11h30 > Tables rondes pour débattre des échanges : scolaires, sportifs, culturels, économiques,...
12h00 > Réunions rapides (« speed meeting ») entre mairies (4 réunions de 10 minutes par mairie)
13h00 > Collation et musique avec le Collectif Angelets de la Terra
14h30 > Clôture de la rencontre
Les Angelets de la Terra estiment qu'il est nécessaire de renforcer les liens entre la Catalogne du Nord et celle du Sud. Nous pensons que le niveau communal est le plus adapté pour relever ce défi. Pour l'instant, peu de communes catalanes sont jumelées, malgré la grande vague de solidarité des communes de Catalogne du Nord survenue après le 1er octobre 2017.
Lors de chaque Trobada les élus présents sont interviewvés et ces vidéos sont diffusées sur les réseaux sociaux:
Il n'est pas impératif de savoir parler le catalan pour participer, car les organisateurs sont là pour aider à fluidifier les échanges si besoin. De nombreuses mairies ont déjà participé à ces rencontres, qui ont débuté en décembre 2023.
Le projet que les Angelets de la Terra veulent promouvoir vise à renforcer les liens avec tous les Pays Catalans, pour des projets culturels, sportifs, scolaires, économiques, touristiques, etc. Le champ de la coopération commencera au niveau municipal, dans le but de l'élargir à toute la société civile, pour gommer les frontières.
L'analyse des besoins et des réalités de chaque territoire nous amène à conclure qu'il est souhaitable d'imaginer de nouvelles modalités d'échanges. Il ne s'agit pas de considérer les jumelages entre communes catalanes, même si elles se trouvent en France et en Espagne, comme des jumelages avec des communes étrangères.
Les Angelets de la Terra ont organisé la première «Trobada sense fronteres de municipis catalans» (rencontre sans frontière des municipalités catalanes), le samedi 9 décembre 2023, à Sant Cebrià de Rosselló (Saint-Cyprien). A cette occasion, les élus représentant la cinquantaine de mairies de Catalogne et de Catalogne Nord participantes ont signé une charte commune et ont échangé sur des possibilités de collaborations.
En 2022, l'association culturelle des Angelets de la Terra a réalisé un sondage auprès des municipalités de Catalogne Nord qui a mis en évidence leur souhait de généraliser les échanges avec le reste de la Catalogne. 39,3% ont répondu oui à la question: "Effectuez-vous des échanges avec une ou plusieurs communes du reste des Pays Catalans?" et 72,7% ont répondu oui à la question: "Souhaitez-vous l'organisation d'événements pour faciliter les rencontres entre les élus de Catalogne du Nord et du Sud?".
En conséquence les Angelets de la Terra ont créé un collectif de municipalités sud-catalanes pour le mettre en lien avec les 120 municipalités nord-catalanes qu'ils ont réuni autour du «Llibre Blanc de Catalunya Nord» et ses 55 propositions en faveur de la langue, de la culture et des traditions catalanes.
La première rencontre entre municipalités de Catalogne Nord et Sud A été organisée avec la mairie de Sant Cebrià de Rosselló. Cette rencontre a débuté à 10 heures par l'accueil institutionnel de la centaine de participants et une prestation musicale de Joan Ortiz. La centaine d'élus présents ont été invités à signer la charte commune: «Carta dels municipis catalans sense fronteres» (Charte des municipalités catalanes sans frontières). Ensuite, ils ont participé à un speed meeting de 6 réunions de 10 minutes pour chaque mairie, organisées autour de problématiques communes tel que la situation géographique (mer, plaine, montagne), la taille, les activités économiques (agriculture, tourisme,...).
Ce fut le moment le plus bénéfique de la journée car tous les participants ont pu se rendre compte, lors d'échanges studieux et conviviaux, à quel point leurs homologues, du Sud et du Nord de la frontière, étaient motivés à l'idée de créer une dynamique commune. À 13 heures, les participants ont pris une collation avant une prestation musicale de Julio Leone et Llamp te Frigui, membres du Collectif Angelets de la Terra de musiciens pour la langue catalane.
Le but de cette première rencontre a permis aux élus de prendre contacte, la pluspart d'entre eux ne s'étaient jamais rentrés, alors qu'au maximum une heure de trajet en voiture les sépare. Les Angelets de la Terra proposent d'organiser deux « trobades sense fronteres » chaque année, dans des communes aux couleurs politiques différentes et de chaque côté de la frontière. Plusieurs maires de Catalogne du Sud ont déjà proposé d'accueillir la prochaine rencontre. La multiplication de ces rencontres générera une envie de développer des projets communs autour de la culture, l'enseignement, le sport, les associations en tout genre, l'entreprenariat et tout ce qui permet d'impliquer la population.
Les Angelets de la Terra feront un suivi de ces échanges et souhaitent que toutes les mairies se joignent à cette dynamique apolitique et transversale. Ils ont invité toutes les institutions du Nord et du Sud à l'organisation des prochaines éditions, afin de pérenniser cet événement.
En signant la charte les municipalités s'engage à:
1- Voter en Conseil Municipal notre participation au projet des «Municipalités sans frontières» destiné à renforcer les liens entre la Catalogne du Nord et du Sud.
2- Désigner une personne chargée de développer des échanges Nord-Sud, mais aussi de favoriser leur continuité en cas de changement d'équipe municipale.
3- Participer aux «Rencontres sans frontières» qui ont pour objectif de rendre visible et de généraliser les liens entre communes catalanes.
4- Inviter régulièrement des élus des municipalités amies et les faire intervenir lors des célébrations officielles.
5- Organiser des sorties pour que les habitants participent aux fêtes de ces communes et créent des liens.
6- Aider les enseignants, les sportifs, les commerçants et les associations à renforcer les liens avec leurs homologues.
7- Programmer des artistes venant de l'autre côté de la frontière à condition qu'il y ait réciprocité et que le catalan soit présent dans leurs créations.
8- Promouvoir la langue, la culture, l'histoire et l'identité communes avec des projets partagés destinés à effacer la fontière mentale.
9- Utiliser en priorité la langue catalane dans le cadre de ces échanges afin d'en améliorer l'usage.
10- Placer cette charte signée dans un endroit visible de notre mairie afin que les visiteurs puissent prendre connaissance de ce projet.
Pour le Pays Catalan, les Pyrénées Catalanes et la Catalogne Nord : changeons le nom du département, retrouvons notre identité
La grande consultation par voie de presse et numérique lancée par la président régionale, Carole Delga, au moment du choix du nouveau nom de la grande région Occitanie, en 2016, est restée en travers de la gorge de beaucoup de Nord-Catalans et a surtout suscité polémique et division. La présidente du Conseil Départemental annonçait dans la presse, fin janvier 2022, vouloir éviter le même scénario entre Pays Catalan et Fenouillèdes. Pas de problème, la solution est toute trouvée: on met Fenouillèdes en sous-titre. Contrairement à ce qui a été fait pour la région Occitanie, dont le sous-titre est Pyrénées-Méditerranée.
La présidente du Conseil départemental veut s'appuyer sur "un certain nombre d'associations et de structures à consulter" et va faire plancher un cabinet spécialisé dès ce printemps. Celui-ci proposera un nom qui sera ensuite soumis à l'avis des Nord-Catalans, sous forme d'un référendum. Pas de problème, on acceptera le nom qui inclura "Catalan", "Catalanes" ou "Catalogne" et qui affirmera l'identité de ce territoire. On ne va pas se chamailler comme en 1970. A l'époque, 85% de la population voulait changer le nom du département, mais chaque catalan revendique un nom différent. Finalement, l'Etat, profitant de ces divisions, a tranché et rien n'a été changé, l'existence des Nord-Catalans a continué à être niée officiellement sur la carte de France. Aujourd'hui, il est probable qu'on nous invoque d'autres excuses pour en arriver à un résultat similaire. C'est la raison pour laquelle les Angelets de la Terra mène une campagne en faveur d'un nom affirmant la catalanité du département. Nous ne voulons pas de "Pyrénées-Méditerranée" pour désigner ce territoire, comme les bruits de couloir nous le laisse entendre!
Un nouveau nom, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, un débat sur le futur de notre territoire et le foisonnement de projets innovants pour le redresser. Peu importe que ce soit Catalogne Nord, Pays Catalan ou Pyrénées Catalanes. Nous n'avons pas la force d'imposer quoi que ce soit et cela fait trop longtemps que nous attendons au milieu du désert. Tout sauf Pyrénées-Méditerranée qui n'a aucune valeur ajoutée par rapport à Pyrénées-Orientales. Affirmons enfin cette identité millénaire dont nous devons être fier. Une identité que nous devons mieux valoriser et partager, comme le font avec succès les Bretons, les Occitans, les Basques, les Alsaciens et les Corses.
L'objectif des Angelets de la Terra est d'amener le débat dans l'espace public, de ne pas laisser le monopole aux cabinets "spécialisés" et aux associations "officielles", afin que toute la population (catalans d'origine ou nouveaux catalans) soit impliquée dans un choix si important. Un choix qui doit amener à un consensus, une prise de conscience collective, une dynamique commune pour notre territoire et ses 470.000 habitants. Pour les Angelets de la Terra, il est évident que la catalanité ouverte et moderne revendiquée par ce nouveau nom se propagera dans tous les secteurs et renforcera le lien social qui est nécessaire pour construire un futur meilleur et un mieux vivre ensemble.
Rappelons que lors de la consultation populaire concernant le choix du nom de la nouvelle région Occitanie l'avait emporté au niveau de toute la région, mais les résultats dans le département étaient sans équivoque: Pays Catalan était largement en tête. Suite à cette consultation, 10.000 Catalans ont manifesté dans les rues de Perpignan, puis 90% des municipalités ont installé des panneaux « Pays Catalan » à leurs entrées. Que faut-il de plus pour comprendre la volonté des habitants du département? Si le nom proposé par le Conseil Départemental ne prend pas en compte cette demande, ce sera un second dénie de l'existence des Catalans en France. Il faut discuter du nom le plus approprié entre Catalogne Nord, Pays Catalan et Pyrénées Catalanes, mais si l'on doit être censurés parcequ'on revendique notre catalanité, que ce soit par le Conseil d'Etat, pas par nos représentants départementaux.
Dans un premier temps, nous proposons à tous ceux qui le souhaitent d'entrer en contact avec nous à info@angeletsdelaterra.com, afin de récupérer nos affiches A2 (42x59 cm) illustrant cet article et de les coller dans les commerces, les mairies, etc. Il faut agir aujourd'hui et se faire entendre. Nous avons bien vu avec le nom Occitanie que les manifestations après que la décision ait été prise, ne servent à rien. C'est maintenant qu'il faut manifester et nous appelons les assiciations, les maires et les autres élus à le faire au plus tôt.
Nous rappelons que les objectifs des Angelets de la Terra pour les trois prochaines années sont:
- Changement du nom du département pour un nom affirmant son identité catalane;
- Création d'un lycée pour la Bressola qui permettra enfin la continuité de l'enseignement en immersion (porté aussi par Arrels) de la maternelle à l'université;
- Augmentation du budget de l'Office Public de la Langue Catalane (OPLC) qui doit passer à 4 Millions D'€uros pour se rapprocher de celui des Basques et des Bretons, en s'inspirant de leurs domaines d'actions;
- Changement du maire de Perpignan qui a affirmé sa ferme opposition à la Bressola et donc à la normalisation de la langue catalane.
Livre blanc de Catalogne Nord et Label Culturel : 115 mairies et 55 propositions pour revitaliser la culture populaire
Les principaux axes du « Livre Blanc de Catalogne Nord » sont la normalisation de la présence du catalan dans l'espace public; l'enseignement en catalan; l'organisation de fêtes populaires et traditionnelles; les liens avec le reste des Pays Catalans; etc...
Le « Livre Blanc de Catalogne Nord » a été élaboré par les Angelets de la Terra avec l'aide de professeurs de l'Université de Perpignan, spécialisés dans la toponymie, l'histoire et l'enseignement du catalan, mais aussi plusieurs acteurs de la vie culturelle, associative et économique de notre département (voir la liste ci-dessous).
Le « Livre Blanc de Catalogne Nord » développe 55 propositions concrètes pour la catalanitéqui ont été soumises à toutes les municipalités nord-catalanes.
Les Angelets de la Terra considèrent que la culture catalane, indissociable de la langue, est un vecteur essentiel de la cohésion sociale en Catalogne Nord et que son avenir dépend en grande partie des actions communales. C'est pourquoi ils ont édité, en 2021, le « Livre Blanc de Catalogne Nord » après avoir créé, lors des élections municipales de 2020, le « Label Culturel Angelets de la Terra » pour tous les candidats qui souhaitaient mener une politique culturelle en catalan, festive et inclusive.
> Télécharger le « Llibre Blanc de Catalunya Nord » en cliquant ici <
Cesc vingt dernières années, face à l'uniformisation et la mondialisation, il y a une prise de conscience de l'importance de faciliter à tous, catalans d'origine ou d'adoption, un accès à la langue et à la culture catalanes. Il y a une demande croissante des populations de retrouver leurs racines ou celles du territoire où elles se sont installées. On retrouve ce phénomène en Catalogne et ailleurs. Les municipalités, au plus près de la population, ont un rôle essentiel dans la transmission et la promotion de ce que nous appelons la « catalanité ».
Les Angelets de la Terra, forts de vingt années d'expérience pour promouvoir une culture catalane ouverte et inclusive, apportent leur soutien aux municipalités qui le souhaitent. En 2020, ils ont proposé aux candidats aux municipales de signer la charte de leur Label Culturel, afin de valoriser leur volonté de mener une politique culturelle en faveur de la « catalanité ». Cette charte comporte trois axes: la normalisation de la langue dans l'espace public et l'enseignement, la promotion de la culture et des traditions, les liens transfrontaliers avec les municipalités sud-catalanes. Début 2021, après les élections, les Angelets de la Terra ont développé ces trois axes en répertoriant tous les moyens d’action des municipalités et en faisant 55 propositions concrètes publiées dans le Livre Blanc de Catalogne Nord.
Une politique linguistique et culturelle en faveur de la catalanité
La politique culturelle en faveur de la catalanité telle qu'elle a été menée jusqu'à présent en Catalogne Nord montre que pour être efficace elle ne peut se limiter à un vague souhait, accompagné de quelques mesures symboliques. Pour obtenir des résultats, il faut se donner des outils et des objectifs qui ont été développés dans le « Livre blanc de Catalogne Nord », en se basant sur les trois axes principaux de la charte du Label Cultural: langue, culture et pays. Nous n'avons plus de temps à perdre car la situation de la langue et de la culture catalanes est critique. Chaque petit pas sera une victoire.
Les éléments mentionnés dans la charte du Label Cultural des Angelets de la Terra et développés dans le Livre Blanc de Catalogne Nord ont souvent plus de force lorsqu'ils sont affirmés dans un plan culturel adopté lors d'une délibération de principe du conseil municipal. Le rôle de cette délibération doit aussi être emblématique : reconnaître l'identité catalane de chaque commune, mais aussi fixer des objectifs réalisables, en fonction des moyens humains et financiers, puis mener des actions concrètes.
Le Livre Blanc de Catalogne Nord oriente vers un bilinguisme généralisé catalan-français, une richesse locale et transfrontalière qu'il est impératif de valoriser. Pour ne pas perdre définitivement cette richesse, il faut généraliser en Catalogne Nord l'enseignement du catalan à l'école et en dehors, la signalétique bilingue et les échanges avec la Catalogne Sud. L'introduction de la langue dans l'espace public doit être encadrée et réfléchie car il ne s'agit pas de faire une faute d'orthographe à chaque mot ou de donner l'impression d'exclure ceux qui ne maîtrisent pas encore la langue catalane.
La question de la politique culturelle est encore plus complexe que celle de la langue: elle se limite souvent à du marketing, de l'animation touristique ou une simple carte postale, bien éloignée de ce qu'est réellement la richesse d'une culture avec plus de 1000 ans d'histoire. Un politique culturelle doit poser la question de la réappropriation pour tous de l'histoire et de l'identité, afin de renforcer la cohésion sociale.
Le rôle des communes dans la diffusion et l'enseignement de la langue catalane
80% des parents sont favorables à l'enseignement du catalan selon une enquête menée en 2018 par le Conseil Départemental, l'Université de Perpignan et la Generalitat de Catalunya. Or, seulement 9% des élèves peuvent l'apprendre en bilingue ou immersif C, faute de moyens pour les accueillir. Comment proposer une offre adaptée à cette forte demande frustrée depuis des décennies?
Si l’enseignement ne relève pas de la compétence de la commune, celle-ci peut faire beaucoup pour favoriser l’enseignement bilingue paritaire: informer les parents sur l’intérêt de cet enseignement, demander des classes bilingues à l'Éducation nationale, à défaut solliciter l’enseignement associatif comme la Bressola, organiser des regroupements pédagogiques intercommunaux, engager des aides maternelles catalanophones et former ceux qui sont déjà sous contrat, favoriser l’affichage et le matériel bilingue dans l’école et proposer des activités périscolaires, ainsi que des animations culturelles en langue catalane.
Il faut que l’environnement des classes bilingues ou d'immersion soit lui-même bilingue et ceci relève en grande partie de la commune qui peut favoriser la présence du catalan dans l'espace public. L’objectif du bilinguisme ne doit pas être limité aux enfants mais assumés par les adultes qui les entourent.
L’éducation commence avant l’école. Les crèches en langue catalane sont une clé importante du succès. Les communes peuvent jouer un rôle direct dans l’ouverture de crèches en langue catalane et française, en donnant l’accès à des locaux pour ces structures, en apportant un soutien financier et en accompagnant les parents dans les démarches administratives.
Des jeunes et moins jeunes de toutes origines ont envie de s’approprier la langue du territoire où ils ont choisi de s'installer. Il y a là une attente importante à laquelle les communes peuvent répondre en organisant des cours de catalan pour les adultes.
Toutes les communes consacrent des budgets souvent significatifs à la culture. Il serait bon de faire une évaluation de la place de la culture catalane dans ces dépenses: mise en valeur de l’histoire, du patrimoine, des traditions locales, soutien aux artistes et productions culturelles locales, promotion des œuvres en langue catalane. Par des appels d’offre ciblés, il appartient aux communes de susciter des projets mettant en valeur la langue et la culture catalanes, de favoriser la création artistique.
Dans les bibliothèques ou médiathèques municipales, l'offre de documents en catalan peut souvent être améliorée. Il faut mettre en valeur ces ressources en invitant les écoles à des lectures et en y organisant des groupes de conversation en catalan.
Autres leviers pour renforcer la catalanité de nos communes
Au niveau de chaque communauté de communes devrait être recruté au moins un animateur catalanophone, spécialement chargé des actions favorisant la diffusion de la langue et de la culture catalanes. Il faut aussi que les communes fassent remonter leurs besoins à l'Office Public de la Langue Catalane (OPLC) afin que des budgets conséquents soient débloqués, comme c'est le cas au Pays Basque ou en Bretagne.
Toutes les communes ont des partenariats divers. Sans renoncer aux autres, les liens avec des communes de Catalogne Sud devraient être particulièrement valorisés pour faciliter la pratique de la langue commune, en développant des liens économiques, sportifs, culturels et entre les écoliers. Actuellement, seulement 10% des communes nord-catalanes ont des liens avec des communes sud-catalanes en raison de la frontière, véritable cicatrice de l'histoire. Les Angelets de la Terra en appellent à une généralisation de ces échanges.
Chaque commune de Catalogne Nord devrait essayer de développer les ateliers ou associations suivantes en le proposant à la population et en se faisant parrainer par les communes du Nord ou du Sud qui ont déjà avancé sur ces sujets: groupe de conversation en catalan, foment de sardana, colla gegantera, correfoc, balls de bastons, équipe de llaguts de rems pour les communes de la côte, etc.
Chaque commune de Catalogne Nord devrait favoriser l'organisation d'activités pour les dates clés liées à la culture catalane en impliquant les association, les commerçants, les écoles et le reste de la population: Goig dels Ous (març), Sant Jordi (avril), Sant Joan (juin), castanyada i vi nou (octobre), Tio de nadal (décembre), festa major (fête patronale), etc.
115 municipis participen al Llibre Blanc de Catalunya Nord
115 municipalités participent au Livre Blanc de Catalogne Nord
Rosselló (subcomarques : Aspres, Corberes, Albera, amb la Marenda, Plana del Rosselló, Riberal del Tet i Salanca).
Vallespir (subcomarques : Alt Vallespir, Vallespir Mitjà, Baix Vallespir).
Conflent (subcomarques : Alt Conflent, Conflent Mitjà, Baix Conflent, Garrotxes, part de l'Altiplà de Sornià).
Capcir
Cerdanya (subcomarca Alta Cerdanya)
CAPCIR (6 municipis / 7)
Angles, els (Les Angles)
Font-rabiosa (Fontrabiouse)
Formiguera (Formiguères)
Matamala (Matemale)
Portè (Porté-Puymorens)
Real (Réal)
CERDANYA (9 municipis / 27)
Ur
Angostrina i Vilanova de les Escaldes (Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes)
Bolquera (Bolquère)
Èguet (Égat)
Er (Err)
Estavar
Font-romeu, Odelló i Vià (Font-Romeu-Odeillo-Via)
Sant Pere dels Forcats (Saint-Pierre-dels-Forcats)
Vallcebollera (Valcebollère)
CONFLENT (28 municipis / 53)
La Llaguna (La Llagonne)
Ralleu (Railleu)
Saorra (Sahorre)
Toès i Entrevalls (Thuès-Entre-Valls)
Aiguatèbia i Talau (Ayguatébia-Talau)
Arboçols (Arboussols)
Campome (Campôme)
Castell de Vernet (Casteil)
Censà (Sansa)
Clarà i Villerac (Clara-Villerach)
Codalet
Conat
Espirà de Conflent (Espira-de-Conflent)
Eus
Fillols
Finestret
Fontpedrosa (Fontpédrouse)
Masos, els (Los Masos)
Mosset
Nyer
Oleta (Olette)
Orellà (Oreilla)
Pi de Conflent (Py)
Rià i Cirac (Ria-Sirach)
Rodès
Tarerac (Tarerach)
Vernet (Vernet-les-Bains)
Vilafranca de Conflent (Villefranche-de-Conflent)
ROSSELLÓ (63 municipis / 92)
Prunet i Bellpuig (Prunet-et-Belpuig)
La Roca d’Albera (Laroque-des-Albères)
Palau del Vidre (Palau-del-Vidre)
Santa Maria la Mar (Sainte-Marie-la-Mer)
Alenyà (Alenya)
Argelers (Argelès-sur-Mer)
Bages de Rosselló (Bages)
Banyuls de la Marenda (Banyuls-sur-Mer)
Banyuls dels Aspres (Banyuls-dels-Aspres)
Barcarès, el (Le Barcarès)
Brullà (Brouilla)
Cabestany
Calmella (Calmeilles)
Cànoes (Canohès)
Casafabre (Casefabre)
Cases de Pena, les (Cases-de-Pène)
Cervera de la Marenda (Cerbère)
Clairà (Claira)
Corbera (Corbère)
Corbera de les Cabanes (Corbère-les-Cabanes)
Cornellà de la Ribera (Corneilla-la-Rivière)
Cornellà del Bercol (Corneilla-del-Vercol)
Cotlliure (Collioure)
Espirà de l'Aglí (Espira-de-l'Agly)
Estagell (Estagel)
Illa (Ille-sur-Têt)
Llauró (Llauro)
Millars (Millas)
Montescot
Nefiac (Néfiach)
Oms
Òpol i Perellós (Opoul-Périllos)
Paretstortes (Peyrestortes)
Pesillà de la Ribera (Pézilla-la-Rivière)
Pià (Pia)
Pontellà (Ponteilla)
Portvendes (Port-Vendres)
Queixàs (Caixas)
Salelles (Saleilles)
Sant Andreu de Sureda (Saint-André)
Sant Cebrià de Rosselló (Saint-Cyprien)
Sant Feliu d'Amunt (Saint-Feliu d'Amont)
Sant Feliu d'Avall (Saint-Feliu-d'Avall)
Sant Genís de Fontanes (Saint-Génis-des-Fontaines)
Sant Hipòlit de la Salanca (Saint-Hippolyte)
Sant Joan la Cella (Saint-Jean-Lasseille)
Sant Llorenç de la Salanca (Saint-Laurent-de-la-Salanque)
Sant Marçal (Saint-Marsal)
Sant Miquel de Llotes (Saint-Michel-de-Llotes)
Sant Nazari de Rosselló (Saint-Nazaire)
Soler, el (Le Soler)
Sureda (Sorède)
Talteüll (Tautavel)
Toluges (Toulouges)
Torre del Bisbe o Torre d'Elna, la (Latour-Bas-Elne)
Torrelles de la Salanca (Toreilles)
Trullars (Trouillas)
Tuïr (Thuir)
Vilallonga dels Monts (Villelongue-dels-Monts)
Vilamulaca (Villemolaque)
Vilanova de Raò (Villeneuve-de-la-Raho)
Vilanova de la Ribera (Villeneuve-la-Rivière)
Vingrau
VALLESPIR (9 municipis / 21)
Arles (Arles-sur-Tech)
Banys d’Arles i Palaldà, els (Amélie-les-Bains-Palalda)
Costoja (Coustouges)
Menera, la (Lamanère)
Montboló (Montbolo)
Morellàs i les Illes (Maureillas-las-Illas)
Reiners (Reynès)
Sant Joan de Pladecorts (Saint-Jean-Pla-de-Corts)
Serrallonga (Serralongue)
Collectif de musiciens de Catalogne Nord pour la langue catalane : 280 enregistrements, 14 albums et de nombreux concert
Depuis 2010, les Angelets de la Terra ont impulsé en Catalogne Nord un renouveau de la musique actuelle d'expression catalane (rock, reggae, électro, pop, punk, rumba...).
Plus d'une centaine d'artistes de toutes origines (majoritairement des professionnels) ont chanté en catalan dans notre collectif alors que la majorité d'entre eux ne parle pas catalan. Cette invitation leur a permis d'exprimer leur attachement à l'identité du territoire où ils vivent en développant un répertoire en catalan qu'ils ont mélangé à leur répertoire en français, anglais, espagnol ou autres langues. Cette diversité est une richesse.
- 14 disques édités dont un « best of » distribué avec la Revue Enderrock;
- plus de 280 chansons en catalan enregistrées;
- de nombreux concerts et festivals dans tous les Pays Catalans;
- "Concerts per la Llibertat" en soutien aux prisoniers et exilés politiques catalans avec 39 groupes du collectif.
Liste non exhaustive de musiciens nord-Catalans du collectif Angelets de la Terra que vous pouvez écouter sur le site des Angelets:
… qui peuvent faire un concert en totalité ou en partie en catalan
Buenasuerte,
Balbino Medellin,
Eric el Català,
Gerard Jacquet,
Julio Léone,
Joan Ortiz,
Llamp te Frigui,
Muriel Perpigna,
Farré & Trichot, ...
… qui ont quelques chansons en catalan dans leur répertoire
Al Chemist,
Annabelle Scholly Lotz,
Blue Sol,
Chris the Cat,
Gaëlle Balat,
La Reskape,
Norha,
Titi Robin & Roberto Saadna,
Romain Lucas,
Rumba Coumo,
Stéphanie Lignon,
...
Les municipalités qui souhaitent promouvoir notre langue peuvent organiser régulièrement des concerts en catalan et favoriser ainsi la vitalité et la création artistique en catalan.
Les municipalités donneraient la priorité aux artistes nord-catalans, tout en favorisant des échanges avec des artistes de tous les Pays-Catalans.
Elles peuvent aussi demander à tous les groupes qu'elles programment d'intégrer du catalan dans leur répertoire, afin de les motiver à utiliser le catalan. De nombreux artistes nord-catalans ont participé au Collectif Angelets de la Terra de musiciens de Catalogne Nord pour la langue catalan même s'ils ne parlent pas catalan ou n'ont pas l'accent (comme cela est le cas pour la plupart des artistes français qui chantent en anglais...).
Enfin, la mairie peut encourager les organisateurs de festivités sur la commune à avoir la même démarche en faveur de la promotion de la langue catalane.
Quelques vidéos de concerts du Collectif Angelets de la Terra de musiciens de Catalogne Nord pour la langue catalane:
Els Angelets de la Terra vam publicar 14 discos que inclouen un "best of" distribuït amb la revista Enderrock, els 4 discos homenatge Giné i 9 recopilatoris (8 + 1 occità-català) :
- Recopilatori n°1 : « Col·lectiu Joan Pau Giné » amb 16 cançons de 12 formacions musicals. Publicat pels Angelets de la Terra i presentat l’11 de setembre de 2010 (Diada de Catalunya).
- Recopilatori n°2 : « Col·lectiu Joan Pau Giné » amb 21 cançons de 21 formacions musicals. Publicat pels Angelets de la Terra i presentat el 7 de novembre 2010 (Diada de Catalunya Nord).
- Recopilatori n°3 : « Homenatge a Jordi Barre », amb 21 cançons de 21 formacions musicals. Publicat pels Angelets de la Terra i presentat a la premsa el 25 de febrer de 2012. La primera cançó del disc és un duo d'en Jordi amb en Cali. Altres grups fan versions de cançons d'en Jordi: La Berne amb Canta Perpinyà; Stéphanie Lignon i d'en Pascal Bizern ens transporten amb Crec i Tan com me quedarà; Llamp te Frigui dona un toc rock a la cançó Els hi fotrem; Norha ens proposa una fusió amb tenores per Torna venir Vicens; Al Chemist van interpretar Parlem català i Davy Kilembé canta Soc de Perpinyà.
- Recopilatori n°4 : « Col·lectiu Joan Pau Giné », amb 22 cançons de 22 formacions musicals. Publicat pels Angelets de la Terra en abril de 2012 per la Sant Jordi.
- Recopilatori « Best Of Col·lectiu Joan Pau Giné » : Editat i regalat amb un numero de la revista Enderrock al setembre de 2012.
- Recopilatoris de 4 discos : Homenatge a Joan Pau Giné pels 20 anys de la seva mort, « Canten Giné » publicat a l’abril de 2014 pels Angelets de la Terra amb « Adiu, ça va » i el consell Departamental de Catalunya Nord. Director artístic : Ramon Faura (de gener a desembre 2013).
- Recopilatori n°5 : « Catalunya Occitània Songs », amb 23 cançons i 23 formacions musicals. Publicat pels Angelets de la Terra i presentat a la premsa el 21 d’abril de 2014 per la Sant Jordi.
- Recopilatori n°6 : « Col·lectiu Angelets de la Terra de músics de Catalunya Nord per la llengua », amb 21 cançons de 21 formacions musicals. Publicat pels Angelets de la Terra i presentat a la premsa el 5 de gener de 2016.
- Recopilatori n°7 : « Col·lectiu Angelets de la Terra de músics de Catalunya Nord per la llengua » amb 20 cançons de 20 formacions musicals. Publicat pels Angelets de la Terra i presentat al gener de 2017.
- Recopilatori n°8 : « Col·lectiu Angelets de la Terra de músics de Catalunya Nord per la llengua ». Publicat pels Angelets de la Terra i presentat el 25 de juny de 2017 durant un concert de Balbino Medellin amb Marina Rossell, organitzat pels Angelets de la Terra i l’Institut Font Nova, al teatre municipal de Perpinyà. En aquest vuitè recopilatori, Llamp te Frigui ha musicat un text de Ramon Faura "Angelets" per retre homenatge als herois, revoltats del Vallespir.
- Recopilatori n°9 : « Col·lectiu Angelets de la Terra en suport als presos, exiliats i represaliats polítics catalans ». Publicat pels Angelets de la Terra i presentat l'octubre de 2018. En aquest recopilatori surten els grups que participaran en els cinc festivals de música, quatre manifestacions festives i reivindicatives, com les cinquanta exposicions amb projeccions, debats i música solidàries organitzades pels Angelets de la Terra entre 2018 i 2019.
Vet aquí el balanç del Col·lectiu Angelets de la Terra després de vuit anys de projectes i trobades: 14 discos (9 discos recopilatoris dels músics de Catalunya Nord, 4 discos en homenatge a Joan Pau Giné amb músics de tots els Països Catalans i un "best of" en la revista Enderrock); participació de quasi 200 formacions musicals (aproximadament 500 músics de tots els Països Catalans); edició del documental « Col.lectiu Joan Pau Giné 2010 » realitzat per Richard Bantegny i Ramon Faura; concerts arreu dels Països Catalans; alguns reportatges amb TV3 (La Sonora), França 3 (Viure al País), França 5 (Echappées Belles); Coup de Cœur Charles Cros pour "Canten Giné"; Premi d'Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla al fundador del Col·lectiu, Ramon Faura; …
> Recopilatori n°1
MUSICIANS OF NORTH CATALONIA
Editat el 11 de setembre de 2010
1 Samir & Lili Baba – L’Estaca (Lluís Llach) 5’13
2 Llamp te Frigui – L’Allioli (Joan Pau Giné) 3’58
3 Cantamu in Puisia (Nanou Planes) – Somni (Coleta Planas) 4’22
4 Joan Pere (Le Bihan) – Endevinalla 1’39
5 Lili Baba – Toca la guitarra 2’37
6 Blues de Picolat – La Noia del Mississipi 3’25
7 R-Can & Tekameli – Cante 3’15
8 Bea – Perpinyà 2’13
9 Llamp te Frigui – Les Minyones de Tuïr 4’55
10 Nicolas Batlle – Aquest matí 3’00
11 100 Grammes de Têtes – Xica Jamaïca 3’48
12 Blues de Picolat – País Bonic 3’37
13 Joan Pere (Le Bihan) – Fulles mortes 4’51
14 Bea – Oda a Giné 3’54
15 Kajal de la Vila – Taxi boig (Joan Pau Giné) 3’30
16 Alexandre Guerrero – L’emigrant 3’07
Agraïments : Benjamin Borne pel mastering , Samir Mouhoubi per la gravació de les cançons 1, 3, 4, 5, 10, 13 i 15 en el menjador d’en Rammon Faura.
> Recopilatori n°2
MÙSICS ROSSELLÓ
Editat el 7 de novembre de 2010
1 Aude & Samir – Els segadors (himne de Catalunya) 3’50
2 Llamp te Frigui – Eskalibad Boys (Didier Borg) 3’13
3 Benquebufa – Adiu, ça va ? (Joan Pau Giné) 4’52
4 Sabor de Perpinyà – Cantem una rumba 4’10
5 Joan Ortiz – Dolça princesa 3’18
6 AOC – La nit mai s’acaba 3’32
7 Guillem Rotg – Somni vodoo 3’34
8 P18 Live Machine (T. Darnal ex Mano Negra) – Guantanamera 4’08
9 Rodney Gemmell – Amor meu 2’46
10 Alex Andujar & Les August – La lluna 3’40
11 Lili Baba & Nanou Planes – El petit tren grog 3’38
12 Florent Berthomieu – Pena 2’42
13 Andy Ritchie – El vi 2’18
14 Zompa – Zompa 4’09
15 Chris The Cat – Snail Boy 3’03
16 100 Grammes de Tête – Santa Espina 2’49
17 Les Petites Laines – Isabel 5’12
18 Barrio Jaleo – Polítics assassins 3’20
19 Jean-Luc Durozier – Amb la lluna 3’50
20 Benquebufa – Bona nit cargol (Joan Pau Giné) 4’05
21 Sabine & Samir – Afegits 5’02
Agraïments : Gerard Jacquet, Coleta Planas, Christian Martinez per la traducció de la cançó 15, Idali Vera, Benjamin Borne pel mastering, Samir Mouhoubi per la gravació de les cançons 1, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 19 i 21 en el menjador d’en Rammon Faura.
> Recopilatori n°3
HOMENATGE A JORDI BARRE
Editat 2011
1 Cali & Jordi Barre – Quan el dia per fi tornarà 4’21
2 Benquebufa – Bages (Joan Pau Giné) 4’05
3 La Berne – Canta Perpinyà (Jordi Barre) 3’16
4 Julio Leone – Venim del Nord 2’19
5 Stéphanie Lignon – Crec (Jordi Barre) 3’08
6 Olive Deus – Ah què és bonic ; Quan ve l’estiu 3’44
7 Pascal Bizern – Tan com me quedarà (Jordi Barre 5’29
8 Kanélé – M’en vaig a peu (Joan Manuel Serrat) 3’03
9 Llamp te Frigui – Els hi fotrem (Jordi Barre) 3’39
10 Norha – Torna venir Vicens (Jordi Barre) 2’45
11 Eskalibad’Boys – Vine amb jo 2’33
12 Chris the Cat – Al vent (Raimon) 3’12
13 Summertime (Anne-Erell Tor) – Mireu el nostre mar 2’44
14 Al Chemist – Parlem català (Jordi Barre) 3’37
15 Xavier Panades – El cuc (Joan Pau Giné) 3’18
16 Disada – On és l’amor ? 4’58
17 Joan Ortiz – Ay mentides 3’35
18 Davy Kilembé – Sóc de Perpinyà (Jordi Barre) 5’39
19 Rumberos Catalans – Han arribat 2’28
20 Abdou Belfquih – Quartets per al rei dels reis 5’20
21 Nathalie Cadet – L’àguila negra (Barbara) 4’56
Agraïments : famílies Giné i Barre, Jep Gouzy per traducció (20), Benjamin Borne per la gravació de les cançons 3, 4, 5, 6, 9, 16 i 20), Gerard Jacquet, Franck Sala i Ramon Faura.
> Recopilatori n°4
Editat en 2012
1 Gerard Jacquet – La plana 2’52
2 Blue Sol – Ara 2’57
3 Berkeley Wright – Un parpanyol (Gerard Jacquet) 4’19
4 Byos (Yolanda Hernandiz) – Un cantic a la senyera (E. Garcia) 3’11
5 Buenasuerte – Compare (Alex Lucas) 5’51
6 Kali Maalem – Com he fet sempre (Mai way) 3’13
7 Romain Lucas – Ollada (Alex Lucas) 5’18
8 Céline Fernandez – Salut a Pesillà (Pau Berga, Franck Sala) 3’23
9 Jako – L’estomp de bosco 2’54
10 La Tchave – Mestissa ron mùsica 1’57
11 Wookie de Llet (B. Sala) – Bressol de tots els blaus (Lluís Llach) 3’16
12 Romane Flachot & Andy Richie – La crisa (Joan Pau Giné) 2’10
13 Raimond le Troubadour – Cecilia (Yves Rouquette) 4’11
14 Summertime (Anne-Erell Tor) – La balada de Lucas 3’40
15 Vodoo (Guillem Rotg) – Arbre de lluna (Père Figueres) 3’15
16 Stéphanie Lignon – Dona 3’21
17 Llamp te Frigui – Què ens queda ? 3’38
18 Benquebufa – Pensa-te (Joan Pau Giné) 3’34
19 Brenn Korz’h (S.Wright) – Mai és lliure 2’55
20 Zompa – Balada impopular 4’49
21 Höly Ghöst – Deixa’m dir una cosa (Sopa de Cabra) 3’36
22 Skamping Car (Alex Andujar) – Terra d’aquí 4’13
Agraïments : Renada Laura Porte per la traducció de la cançó 16, família Giné, Benjamin Borne pel mastering, Gerard Jacquet per la traducció de la cançó 9, Pierre Mugnier-Wright Shede Prod, Franck Sala i Ramon Faura.
> Recopilatori n°5
CATALUNYA OCCITANIA SONGS 1
Editat el 21 d’abril de 2014
1 Joan Pau Verdier (Perigord) – Filh de lop 4’20
2 Gerard Jacquet (Rosselló) - Una mala concurrència 3’18
3 Igor (Perigord) – Toca maneta 4’48
4 Llamp te Frigui (Rosselló) – Papà Sardà 3’04
5 Talabast (Perigord) – Los Caulhets 4’06
6 Muriel Falzon (Rosselló) – Venim del Nord venim del Sud (Llach) 2’52
7 Peiraguda (Perigord) – Sèm e serèm 3’56
8 Donallop (Illes Balears) – Jo és la mar (Joan Pau Giné) 2’58
9 Almacita (Perigord) – Camina 3’20
10 Albert Bertomeu (País Valencià) – Bruixes de l’amor (JP. Giné) 3’09
11 La Torna (Perigord) – La marçolada (M.Chapduelh) 2’21
12 Soham (Occitània) – L’amic Jordi (J-Pierre Lacombe-Massot) 4’46
13 Les Bizbilles (Perigord) – Vaqui 2’56
14 Samuel Arba (Sardenya) – Avui plou (Joan Pau Giné) 3’22
15 Terre d’Avril (Perigord) – Lo darrier somni (C. L-Diaz, T.Parsat) 4’51
16 Donadagua (Rosselló) – El teu amor (Dusminguets) 3’23
17 Enllà (Rosselló) – Abril 74 (Lluís Llach) 2’25
18 Céline Figueras (Rosselló) – I només amb l’amor (J.Brel) 3’21
19 Lluís Vicent (País Valencià) – Cant per l’amiga (Joan Pau Giné) 3’45
20 Yannick Palomino (Rosselló) – Sóc català del Nord 3’04
21 Les Batteurs Rient (Perigord) – Los sacrifias 3’22
22 Sono Loco (Perigord) – Dangerosa 4’04
23 Neva (Rosselló) – Catalunya 3’43
> Recopilatori n°6
MÚSICS DE CATALUNYA NORD PER LA LLENGUA
Editat el 5 de gener de 2016
1 Balbino Medelin – I si canto trist (Lluís Llach) 3’28
2 Llamp te Frigui & Gerard Jacquet – Electrificat (G.Jacquet) 2’44
3 Ghetto Studio – Gatalans (Julio Leone) 4’34
4 Jimmy Vila – Passa 3’05
5 AJT – Els segadors 4’21
6 Blues de Picolat – La maleta (K.Moore/C.Sarrat) 4’41
7 La Reskape – Tots anem a sortir (C.Canal/J.N.Trac) 3’55
8 Un Air de Fête – Il.lusions (Joan Pau Giné) 2’47
9 Buenasuerte & Cobla Tres Vents – Ventilador (Alex Lucas) 5’16
10 Delphine Bassols – Què és una vida? 4’13
11 Joan Ortiz – És la terra 3’34
12 Pascaline – Els contrebandistes 3’03
13 Lisa – Boig per tu (Sau) 3’02
14 Padya – Jo vinc d’un silenci (Raimon) 2’37
15 Eric Ragu – Declaro 3’15
16 Gipsy Nur Project – Cor segellat (Núria Jaouen) 5’17
17 Pepper N’Soul – Hard Time 3’39
18 Brain Market – Nina una nit 2’49
19 Norha – La gent puta (Joan Pau Giné) 4’51
20 Stéphanie Lignon – Renunciar (Joan Pau Giné) 2’02
21 Sergi López & Bulma – Perpinyejar (Joan Pau Giné) 4’35
Gravació i mescla : Ivàn Lorenzana, associació cultural Crearte (16) ; Producció : La Horde – Label Sauvages modernes (1) ; Arranjaments : Jean-Frédéric Ciaravolo (12) ; Agraïments : Franck Sala i Ramon Faura.
> Recopilatori n°7
MÚSICS DE CATALUNYA NORD PER LA LLENGUA
Editat al gener de 2017
1- Llamp te Frigui – Corrandes d’eili (Père Quart) 3’40
2- Virginie Turquin – No em planyo de res 2’25
3- Annabelle Scholly Lotz – Cançó per a les dones (Guillem d’Efak) 4’45
4- Ghetto Studio – Salta, salta 2’43
5- AJT – Voldria5’35
6- Univers-Sales – Pensant en veu alta 3’39
7- La Reskape – És un país 3’53
8- Christine – Aquell infant 3’26
9- Buenasuerte – M’en vaig a peu (JM.Serrat) 4’17
10- Sylvie Rodriguez – Passatge obligat (S.Rodriguez, S.Lignon) 3’58
11- Vincent Vila – Cap idea 4’31
12- Nayah Mestres – Pren el temps de viure (J.Tocabens) 4’38
13- Blues de Picolat – Bye bye 3’54
14- Trio Sensible – Tan com me quedarà (Jordi Barre) 4’42
15- Els Missatgers – Abril 74 (Lluís Llach) 3’21
16- Rumba Coumo – De Perpinyà a Barcelona 3’24
17- The Lost Station – Llibertat 3’36
18- Goulamas’k – Skatalunya 5’34
19- Dégradin Amélia – El cant dels ocells 3’14
20- Jean-Baptiste Sparr Trescases – Els hi fotrem (Jordi Barre) 3’46
> Homenatge a Joan Pau Giné pels 20 anys de la seva mort
« Canten Giné »
Editat a l’abril de 2014 amb Adiu, ça va.
Director artístic : Ramon Faura (de gener a desembre 2013)
Les versions d'en Giné es poden escoltar a deezer
CD1 (Canten Giné)
02 Verdcel - La marinada 5:41 (altre video)
03 Meritxell Gené – Espieu 3:48
04 Patch - Hi pensem 3:28
05 Strombers – Nina 4:25
06 Ghetto Studio – Camins 2:12
07 Relk - El meu país 3:47
08 Norha - La gent puta 4:45
09 Clara Andrés - Taxi Boig 3:24
10 9son - La lletra 3:34
11 Albert Jordà - Records de vida 3:55
12 Es Reboster - Dones que sun estimat 2:58
13 Enric Cabra - Avui plou 3:42
14 Els Papalagi - Diguem-ho 4:05
15 Sergi López i Bulma – Perpinyejar 4:32
16 Llamp te Frigui - M'agrada pas 2:42
17 Rumb al Bar - La rata panera 3:31
18 Gerard Jacquet i Marina Rosell - L'allioli 3:32
19 Òwix - Un simple militant 2:57
20 Sam Destral - Afer de gustos 2:19
21 Carles Dénia - Les Bruixes de l'amor 4:06
22 Marta Rius - Fulla de tardor 3:13
CD2 (Canten Giné)
01 Projecte Mut - El món rodó 3:43
02 Stéphanie Lignon – Renunciar 2:00
03 Dídac Rocher - Cant per l'amiga 3:30
04 La Carrau - Cançó descolorada 3:27
07 Aires Formenterencs - El meu país II 2:58
06 La Senyoreta Descalça - El cuc 3:27
08 Montse Castellà – Mercedès 4:29
10 Titot i David Rossell - El temps de les cireres 3:09
09 Buenasuerte – Bages 4:25
11 Atzukak - El 10 de maig 3:44
12 Bonobos – Drapeus 3:29
13 Els Delai - Els homes de la por 2:48
14 Josep Tero - Ho farem 3:39
15 Cesc i Montse - Pensa-te 2:24
16 Claudia Crabuzza - Si voleu fer guerra 4:06
17 Jordi Montañez - Els dies 3:12
18 Oriol Vilella - Les darreres noves 3:48
19 Smoking Soul's - L'home de cent anys 2:58
20 Corrandes son corrandes - Pallagostins de l'estiu 2:18
21 Pere Vilanova - Vetllada 4:16
22 Malva de Runa - Darrer camí 3:59
CD3 (Canten Giné)
01 Rosa Luxemburg - Hi ha los 2:50
02 Andreu Valor - Parla-me, diguis-me coses 4:26
03 Gent del Desert - Les velles barques 2:46
04 Claudio Gabriel Sanna - La, la la, la 3:38
05 Marta Elka - Argelers 4:03 (altre video)
06 Josep Romeu - Demanem la paraula 2:41
08 Carles Belda - El xirment 2:47
09 Lilo - Un dia tindrem fred 3:05
10 Maitips - Adiu, ça va 2:58
11 Xavier Baró - Montparnasse 5:04
12 Blues de Picolat - Strip Tease 3:04
13 Dekrèpits - Hi ha merda a mar 4:07
14 Narcís Perich - D'un banda a l'altra del rideu 4:30
16 Serge Lladó - El grec 2:50
17 Albert Bertomeu - Sant Marc 3:36
18 Micu - Qüestió d'amor 3:13
19 Llunàtiques - Els mestres educats 3:15
20 Ull de vellut – Catalana 3:17
21 Benquebufa - Je chante 4:18
22 Ai Carai! - Mare gata 2:51
23 Romane Flachot i Andy - La crisa 2:08
CD4 (Canten Giné)
01 El Diluvi – Peret 3:13
02 Peret Reyes - L'adam 3:34
03 Pascal Bizern – Diumenge 2:18
04 Joan Ortiz - Un pais nou 4:22
05 Flying Frogs - Recital Circus 1:13
06 Un air de fête - Les il.lusions 3:40
08 Igor - La caputxeta roja 3:55
09 La caixa de gel - La televisio 4:18
10 Yacine i the Oriental Groove - Cremat l'home 1:40
11 Antoni Nicolau – Padrina 3:49
12 L'Exèrcit d'Islàndia – Desig 3:35
13 Anton Abad - Bona nit cargol 2:08
15 Atz'Art - L'home del bosc 3:57
16 Dealan - Darrer Cami 4:04
17 Hugo Mas i Caçacérvols - Hi pensem 4:10
18 Inuk - La gent puta 1:31
21 Sr. Mit - Les velles barques 2:52
22 Riu - Diguem-ho 3:45
24 Xavier Panades - El cuc 3:18
(dessin illustrant cet article de Jaume Gubianas Escudé)
Les Angelets de la Terra du XXIᵉ siècle : avec des guitares à la place des trabucs, ils sèment la catalanité depuis un quart de siècle
Els Angelets de la Terra est une association de Catalogne Nord fondée en 2001 pour promouvoir la langue et la culture catalanes et les liens avec la Catalogne. A l'origine un club de rugby de l'USAP, ils ont publié 39 magazines bilingues, contribué à la création de clubs USAP, formé un collectif de musiciens et organisé des activités culturelles, notamment un soutien aux droits des Catalans du sud avec des manifestations et des festivals. En 2020, ils ont lancé le Livre blanc de la Catalogne du Nord avec 55 propositions culturelles, et en 2023 ils ont lancé les Rencontres sans frontières des communes catalanes. L’été 2025, els Angelets lancent la campagne "Une langue sans frontières", en proposant à toutes les municipalités catalanes d’approuver une motion exprimant leur volonté de défendre la langue commune et de renforcer les liens Nord-Sud. À l’occasion de la campagne des élections municipales en Catalogne Nord, ils publient le Livre Blanc de l’enseignement catalan, en soulignant la nécessité de généraliser l’enseignement bilingue dans les villes et villages, de la maternelle au lycée. 2026 sera l'année des travaux du Centre Culturel de Catalogne Nord que les Angelets créent à Ribesaltes.
De 2001 à 2009, les Angelets de la Terra ont aidé à créer des penyes de l'USAP (groupes de supporters) dans tous les Pays Catalans, afin de participer à effacer les frontières physique et psychologique entre les territoires où les gens parlent catalan. Tout d'abord penya officielle de l'USAP, les Angelets deviennent aussi une penya des Dragons Catalans car ces deux clubs de rugby sont des symboles importants de la catalanité en Catalogne Nord.
Depuis 2006, les Angelets organisent de nombreux évènements culturels pour promouvoir la langue et la culture populaire catalanes au travers de festivals, concerts, correfoc, lectures de poésies, cinéma, théâtre, expositions, débats, randonnées,...
Voici les principaux projets des Angelets de la Terra:
- Revista Angelets de la Terra (2001-2009): 39 exemplaires de 16 pages en couleur, en catalan et en français, sur les Pays Catalans.
- Sant Jordi Jove (2006-2008): concours de dessin des classes de l'APLEC, une émission de radio en direct, un concert sur le Quai Vauban de Perpignan.
- Nit de Poesia (2006-...): soirée poétique et musicale avec des poètes de tous les Pays Catalans dans différents lieux de Perpignan et communes.
- Descobrir Catalunya (2006-2011): déplacements en bus et excursions pour faire découvrir aux citadins les fêtes traditionnelles comme la Trobada del Canigó ou la Festa de l'Os.
- Català a la SNCF (2006-2007): campagne pour demander une signalétique en catalan et français dans les gares de Catalogne Nord, avec le soutien de la Plataforma per la Llengua.
- Setmana per la Llengua (2007-2012): un festival avec des soirées à thèmes, destiné à montrer la diversité de la création artistique en catalan dans le cinéma, la musique, la poésie et le théâtre. Organisé la première année à l'Université de Perpignan en collaboration avec dix associations d'étudiants africains, puis dans différentes communes.
- Cine'Cat (2007-2011): en collaboration avec le Cinéma Castillet, nous avons présenté une quinzaine de films et les deux documentaires que nous avons réalisés
- Els Cremats de la Tet (2007-2008): la "colla de diables" des Angelets qui a organisé ou participé à une dizaine de correfocs.
- Col·lectiu de músics de Catalunya Nord per la Llengua (2010-...) : collectif destiné à favoriser la création de musique actuelle en catalan; participation de plus de 100 groupes de tous styles musicaux (reggae, jazz, rock, électro,...); 14 disques édités dont un « best of » distribué avec la Revue Enderrock; plus de 200 morceaux enregistrés; des dizaines de concerts dans tous les Pays Catalans.
- Homenatge a Joan Pau Giné (2013-2014): les Angelets ont coordonné 90 groupes de tous les Pays Catalans qui ont fait des versions de toutes les chansons de Giné.
- Label Culturel pour les mairies de Catalogne Nord (2020-...): en faveur des échanges transfrontaliers, de la culture et des traditions catalanes.
- etc.
En 2018 et 2019, nous avons été l'une des pièces maîtresse du mouvement populaire en solidarité avec les prisonniers et exilés politiques Sud-Catalans.
Une cinquantaine de maires de toute la France, principalement de Catalogne Nord, ont accueilli "Visca per la Llibertat" l'exposition de photojournalisme des Angelets (43 photographes et 242 photos), la projection d'un documentaire et les débats sur le référendum d'autodétermination en Catalogne, les quatre festivals "Concerts per la Llibertat" (39 groupes de notre collectif avec des invités Sud-Catalans et Occitans) et la "Trobada per la Llibertat" avec 20 poètes de Catalogne Nord et Sud.
Le 19 octobre 2019, nous avons organisé la grande « Manifestation pour la liberté et la démocratie » à Perpinyà, en présence d'une quarantaine de maires et adjoints, de conseillers régionaux et départementaux, des deux sénateurs et de 2000 personnes (selon L'Indépendant).
De nombreuses associations et personnalités ont participé à cette manifestation unitaire: Ligue des Droits de l'Homme; Penyes de l'USAP, des Dragons Catalans et du FC Barcelona; Maire de Perpinyà et président de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole; Collectif des 100 maires solidaires de Catalunya Nord; Vice-président du Conseil Départemental Nicolas Garcia; vice-président du Conseil Régional Guy Esclopé; Fédération Sardaniste du Roussillon; Association de la Flamme des Pays Catalans; etc.
Début 2020, les Angelets de la Terra ont souhaité se centrer davantage sur les problématiques de Catalogne Nord et amplifier leur collaboration avec les élus locaux, en proposant à tous les candidats aux municipales de porter le « Label Culturel des Angelets de la Terra » et de signer leur charte.
En avril 2021, les Angelets ont rédigé 55 propositions concrètes afin de donner des outils aux municipalités souhaitant développer les trois axes de la charte:
- Normalisation de la présence du catalan dans l'enseignement et l'espace public;
- Promotion de la culture, de l'histoire et des traditions populaires catalanes;
- Amplification des échanges économiques, culturels, sportifs, scolaires et associatifs avec le reste des Pays Catalans.
En mai 2021, 55 municipalités de Catalogne Nord ont adhèré à une partie ou à la totalité de ces propositions et collaborent à la rédaction du « Livre Blanc de Catalogne Nord » où elles ont énoncé leurs projets et actions.
El juny de 2022, els Angelets vam editar la segona edició del Llibre Blanc de Catalunya Nord, aquesta vegada amb la participació de 115 municipis dels 198 municipis catalans. Hem constatat que aquest compromís a implementar almenys una de les 55 propostes del Llibre Blanc ha afavorit un replantejament de les polítiques municipals en favor de la cultura catalana, amb exemples com la multiplicació de les Festa Major i les Festes Catalanes.
Aquesta segona edició del Llibre Blanc va incloure també una enquesta realitzada per l’associació a totes les alcaldies per conèixer la seva posició sobre cadascuna de les 55 propostes. Es va revelar que una immensa majoria de les comunes volen desenvolupar intercanvis amb municipis de Catalunya Sud, mentre que només una petita part manté actualment vincles actius amb el sud.
Trobades sense Fronteres
Els Angelets vam entrevistar diversos càrrecs electes per comprendre les raons de la manca d’enllaç entre el nord i el sud de Catalunya. Va emergir que el marc dels agermanaments és massa feixuc administrativament, que els vincles es perden quan hi ha canvis de govern municipal i que limitar els intercanvis a un únic municipi no és satisfactori. Sovint és possible desenvolupar intercanvis esportius amb un municipi, escolars amb un altre i culturals amb un tercer.
A partir d’aquest diagnòstic vam organitzar la primera Trobada sense Fronteres a Sant Cebrià de Rosselló (Saint-Cyprien) el desembre de 2023, amb la participació d’una quarantena de municipis de Catalunya Nord i Sud. Allà es va establir una carta, signada per tots els participants, que defineix el tipus de relacions que volem impulsar entre els municipis. Es va decidir celebrar dues trobades anuals, una al nord i una al sud.
La segona trobada va tenir lloc a Bàscara (Empordà), la tercera a Tuïr (Rosselló), la quarta a Campllong (Gironès) i la cinquena al Centre Cultural de Catalunya Nord creat pels Angelets a Ribesaltes. Una centena de municipis han participat en aquestes trobades, amb representants de tots els corrents polítics. La llengua dels intercanvis és el català, ja que hem considerat que una de les causes del fracàs de les polítiques transfrontereres subvencionades els darrers 30 anys és que han estat plantejades com a trobades franco-espanyoles. Les Trobades sense Fronteres són, en canvi, trobades catalano-catalanes i es desenvolupen naturalment en català.
A Catalunya Nord, alguns electes parlen poc català i d’altres encara no el parlen, com és el cas dels batlles de Vilafranca de Conflent, Clairà o de la batllessa de Vilamulaca. Tot i així, tots comparteixen la voluntat de defensar la llengua i la cultura catalanes.
L’estiu de 2025, els Angelets vam proposar a tots els municipis de Catalunya Nord i Sud una moció demanant el reconeixement oficial del català per part de la Unió Europea i reafirmant la voluntat de reforçar els vincles entre Nord i Sud. El desembre de 2025, aproximadament 200 municipis ja l’havien aprovat. La moció serà presentada el 30 de gener al Parlament de Catalunya, en presència del president del Parlament, en una trobada que equivaldrà a la 6a Trobada sense Fronteres.
Està igualment en estudi organitzar una trobada sense fronteres a la Cambra de Comerç i Indústria de Perpinyà, amb la participació de les cambres de comerç de Catalunya Sud i de tots els municipis que ja participen a les Trobades. El tema de la 7a Trobada sense Fronteres serà els intercanvis econòmics, i per això ja s’han iniciat contactes amb les cambres de comerç del País Basc per convidar-les i perquè puguin presentar la seva cambra de comerç transfronterera, creada el 2010.
Col·laboradors dels Angelets de la Terra a Catalunya Nord (2001-2020)
Universitat de Perpinyà, Casa de la Generalitat a Perpinyà, Ligue des Droits de l'Homme, La Ligue 66, Le Portail à Roulettes (Salses), L'Anthropo (Perpinyà), La Fabrica (Illa), Cinéma Castillet, Col·lectiu Joves del Rosselló, Casa Musical, Centro Espagnol, Regidoria Catalana de Perpinyà, Le 35 Quai Vauban, Le Théâtre des Hautes Rives, Le Théâtre de la Complicité, Le Théâtre de L'Echappée, Le Théâtre Primavera, La Bressola, Porta dels Països Catalans, Ida y Vuelta, Federació per la Llengua, Centre Cultural Català del Vallespir, Angelets del Vallespir, Radio Zigomar, France Bleu Roussillon, Arrels, APLEC, Perpignan TV, Federació Sardanista del Rosselló, Agissons Pays Catalan, Associació de la Flama dels Països Catalans, Comité international des feux de la Saint-Jean, Actions Pays Catalan, Penya Bronca 2003, Penya de l'Aspre, A 100 Mètres du Centre du Monde, L'Archipel Contre Attaque, Penyes Blaugranes de Catalunya Nord, Penya dels Trabucaires amb la USAP, Penya dels Dragons del Riberal, Penya Catalans Endavant, Terre de Pierres, Els amics del castell d'Òpol, Bureau des Etudiants, Associations Africaines de l'UPVD, Renaissance de Vernet Salanque, Prats Endavant,...
Col·laboradors dels Angelets de la Terra en els Països Catalans (2001-2020)
Casal Jaume Primer de Vila-real, Col·lectiu Ovidi Montllor (País Valencià), Generalitat de Catalunya, Enderrock, Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, Tradicionarius (Gràcia, Barcelona), Via Fora (Gràcia, Barcelona), El Forn (Girona), Tercera Via (Santa Perpetua de Mogoda), Universitat Nova Història (Montblanc), CAL, Vilaweb, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Assemblea Nacional Catalana, Associació Catalana pels Drets Civils, Consell per la República, Institut Català de les Empreses Culturals, Associació de Sales de Concerts de Catalunya, Fira Mediterrània, Associació de Productors i Editors de Catalunya, Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural de la Generalitat de Catalunya, Associació de Representants, Promotors i Managers de Catalunya, Associació Professional de Músics de Catalunya, Correllengua, APPEC, Unió de Músics de Catalunya, Associació de Músics i Intèrprets en Llengua Catalana, Xarxa Vives d'Universitats,...
Col·laboradors dels Angelets de la Terra en altres nacions sense estat (2001-2020)
-Bretagne: Festival du Livre en Bretagne (Carhaix), Ai'ta, ...
- Occitània: Calandreta, Casal Català de Montpeller, Casal Català de Tolosa, La Carmagnole (Montpeller), La Tor deu Borrèu (Pau), ...
- Euskadi, Pays Basque: Demo, Mediabask, Kalostrape, Ostatua, ...
Qui est Ramon FAURA i LABAT, coordinateur des projets de l'association des Angelets de la Terra?
Ramon Jordi Joseph Faura i Labat (né à Perpignan en 1979) est une personnalité de la vie culturelle et militante en Catalogne Nord. En 2001, après avoir appris le catalan lors d'une année ERASMUS à Girona, il fonde l’association Angelets de la Terra, devenue une référence pour la diffusion et la dynamisation de la culture catalane dans le Roussillon et le reste de la Catalogne Nord. Sous sa direction, l’association a organisé de nombreux concerts, expositions, festivals et campagnes de sensibilisation pour la normalisation du catalan. Il a également développé plusieurs réseaux avec l'objectif de recatalaniser la Catalogne Nord: réseau des penyes de l'USAP en Catalogne Sud; collectifs de musiciens, de poètes et de photographes; réseau de municipalités catalanes du nord et du sud, visant à renforcer la coopération, à effacer les frontières et donner une visibilité à la réalité nordcatalane au-delà des frontières administratives. Il écrit des articles, en particulier dans la revue bilingue des Angelets de la Terra (2001-2009), participe à des débats dans tous les Pays Catalans, en Corse, Bretagne, Pays Basque, Alsace, Occitanie et Savoie. Plus récemment, il a lancé la création d’un centre culturel catalan à Rivesaltes, comprenant une exposition permanente dédiée à son père, le peintre Ramon Faura Llavari, et à la mémoire de la résistance antifasciste représentée par ses grand-pères Joseph Labat et Ramon Faura Obac. Ce centre culturel accueillera toutes les associations désireuses de promouvoir la culture, la langue et l'identité catalane.
Qui est son père, l’artiste peintre Ramon Faura Llavari ?
Ramon Faura Llavari (Barcelone, 1945 – Lloret de Mar, 2022) fut un touche à tout principalement connu pour sa peinture, mais aussi pour son travail comme chef d'entreprise. Il a étudié à l’école de la Massana à Barcelone et dans l'atelier de Joan Miró. Opposant à la dictature franquiste, il s'est installé en Catalogne Nord en 1968, d'où il faisait passer des tracts qu'il amenait clandestinement dans les "pisos lliures" de Barcelone. À Perpignan, il a développé une œuvre très personnelle, marquée par le surréalisme et l’expressionnisme, avec des références fréquentes à la nature humaine. Il a exposé régulièrement dans des galeries en Catalogne, France, Espagne, Italie, Allemagne et dans les Pays de l'Est. Après sa mort, son œuvre continue d’être reconnue, notamment à travers l’exposition permanente initiée par sa femme et son fils, mais aussi par des ventes de ses toiles dans les salles des ventes de Paris et Londres.
Qui est son grand-père maternel, le paysan et résistant Joseph Labat ?
Joseph Labat (Lys, Béarn, 1915 – 2009) était un paysan qui s'était engagé en tant que chef de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Son petit-fils a découvert ses faits d'armes dans les livres d'histoire car il n'en parlait jamais. Issu d’une famille paysanne, il grandit dans la vallée d'Ossau et devint une figure de la lutte contre l’occupation nazie en Béarn. Il fut membre actif des Francs-Tireurs et Partisans (FTP), l’un des mouvements les plus actifs de la Résistance, organisé par le Parti communiste français. Il coordonna des actions de sabotage, de collecte d’informations et d’aide aux fugitifs, mettant régulièremet sa vie en jeu. Son parcours a été relaté dans des ouvrages historiques et sa figure symbolise le lien entre la lutte pour la liberté et la transmission des valeurs pour son petit-fils Ramon Jordi Joseph Faura i Labat.
Qui est son grand-père paternel, l'industriel et commandant de l'armée républicaine Ramon Faura i Obac
La famille Obac, du côté du grand-père Ramon Faura i Obac (1900-1992), est une lignée catalane ancienne et prestigieuse, dont l’histoire remonte au IXe siècle. Un ancêtre a reçu des terres près de Barcelone en récompense de ses exploits militaires à l’époque de Charlemagne. Cette propriété, exploitée par la famille pendant des siècles, est aujourd’hui connue sous le nom de Parc Natural de l’Obac. La grande maison familiale, la Casa Nova de l’Obac, qui est aujourd'hui un musée, a longtemps été le centre de la vie familiale, servant à la fois de résidence et de refuge lors des épidémies ou des périodes troublées. La famille Obac a joué un rôle notable dans la gestion forestière et industrielle de la région, la grand-mère de Ramon Faura-LLavari ayant été la dernière gestionnaire du domaine.
Ramon Faura i Obac fut commandant dans l’armée républicaine durant la Guerre civile espagnole, il fut responsable des usines d’armement de la Generalitat de Catalogne, un poste stratégique dans la lutte contre les forces franquistes. Son engagement et ses responsabilités témoignent du rôle central de la famille dans l’histoire politique et industrielle de la Catalogne du XXe siècle.
Chronologie
Ramon Jordi Faura i Labat (Perpignan, 1979), militant pour la langue et la culture catalanes en Catalogne Nord au travers de l'association "Angelets de la Terra" qu'il a créée en 2001. Fils d'un Catalan de La Selva et d'une Occitane du Béarn.
En 2000, il fait un Erasmus à l'Université de Gérone pour apprendre le catalan. Il a également étudié aux universités de Perpignan, Tolosa et Utrecht (Pays-Bas).A vingt et un ans, il co-dirigeait la plus ancienne entreprise de France (Prats Dumas, Dordogne, 1309), où il travaille toujours vingt ans plus tard.En 2001, il crée l'association culturelle des Angelets de la Terra qui sera, dans un premier temps, un groupe de supporters de l'USAP, puis des Dragons Catalans, équipes de rugby à XV et XIII de Perpignan. Il a contribué à la création d'une vingtaine de groupes de supporters à travers les Pays Catalans et a publié 39 numéros du magazine « Angelets de la Terra », en catalan et en français, jusqu'en 2009 (quand il a eu un grave accident de voiture).En 2004, dans le cadre de la "Nit de Sant Jordi" organisée par Òmnium Cultural, Ramon a reçu le Prix du journalisme pour son reportage publié en catalan dans le mensuel valencien El Temps : « L'USAP, outil de recatalanisation ».La même année, il se présente comme indépendant aux élections départementales et obtient 4% des suffrages. En 2008, il obtiendra le meilleur résultat pour une candidature catalaniste en Catalogne Nord avec 8%.En 2006, il commence à organiser des événements culturels et festifs avec les Angelets de la Terra (Hommage à Joan Pau Giné, Sant Jordi Jove, Descobrir Catalunya, Diada de Catalunya Nord, Nits de la Poesia, Cine'Cat, ...).
En 2010, création du Collectif Angelets de la Terra de musiciens pour la langue à la suite de la quatrième édition de la Semaine de la Langue que les Angelets organisent jusqu'en 2012.En 2017, Ramon a reçu le Prix d'Action Civique de la Fondation Carulla.En 2018 et 2019, les Angelets organisent des concerts, des manifestations et des expositions en solidarité avec les prisonniers politiques, en collaboration avec 50 communes de l'Etat français.
En 2020, les Angelets décerneront leur « Label Culturel des Anges de la Terre » à 23 listes candidates aux élections municipales en Catalogne Nord (13 seront victorieuses).
En 2021, les Angelets publient le « Llibre Blanc de Catalunya Nord » (Livre Blanc de Catalogne Nord) avec 55 propositions pour le catalan auquel participent 55 mairies de Catalogne Nord.
En 2022, ils publient une deuxième édition avec la participation de 115 mairies sur les 198 mairies catalanes en France.
En 2023, les Angelets organisent la première "Trobada sense Fronteres de municipis catalans" (rencontre sans frontière des municipalités catalanes". Une activité qui comptait cinq édition en 2025 et une centaine de mairies participantes.
En 2025, les Angelets ont proposé aux mairies de Catalogne Nord et Sud de voter une motion afin de revendiquer la défense de la langue commune et la solidarité mutuelle.
Origines familiales
L'histoire et les origines d'un individu influencent le développement de sa pensée et sa trajectoire. Par conséquent, il peut être intéressant de mieux connaître Ramon Faura à travers la présentation personnelle qui suit.
Fils d'une restauratrice occitane béarnaise. Le grand-père maternel de Ramon a été emprisonné avec André Malraux pour avoir saboté des installations de l'Allemagne nazie et organisé des réunions de résistants dans sa ferme.
Fils d'un peintre, élève de Joan Miró à l'école de la Massana à Barcelone, originaire de la Serra de l'Obac où sa famille vit depuis le IXe siècle, avec des ancêtres aux commandes des Segadors de Terrassa. Le grand-père paternel de Ramon participait à la production d'armes pour le gouvernement de Catalogne pendant la Guerre Civile.
Ses parents se sont rencontrés à Bordeaux, dans le restaurant de sa mère, qui figurait dans le guide "Gault et Millau". Ils sont allés vivre au Mas d'en Simon qui était entièrement en ruine et l'ont restauré. C'est ici que Ramon et son frère Marc ont fait leurs premiers pas, au milieu des vignes et des amandiers, au pied du château de Queribus, dans la commune de Tautavel. La famille déménage ensuite successivement à Fourques, au Soler, à Saint Cyprien, Perpignan et Saint-Estève. Il a étudié à l'université avec l'envie de tout essayer, notamment les échanges européens à Gérone et Utrecht près d'Amsterdam.
Un sentiment national catalan
Ramon en est arrivé à l'hypothèse que l'éveil de sa catalanité a commencé lorsqu'il s'est rendu compte que, bien qu'étant catalan, il ne pouvait pas communiquer avec ses grands-parents et ses proches en catalan. Une frustration de ne pas parler leur langue dont souffrent de nombreux Catalans du Nord.A cinq ans, il hissait déjà haut les couleurs catalanes, lors d'une manifestation au Coll de Manrella (Agullana, La Vajol), en hommage au président Lluís Companys arrêté par la milice française et remis à la dictature de Franco par les nazis, puis fusillé à Barcelone.
Le cours pour adultes de Saint-Cyprien, où il se rendait avec ses parents et son frère, était ennuyeux pour un garçon de 7 ou 8 ans, mais il lui semblait déjà important d'y participer chaque semaine. La classe catalane du regretté dessinateur Jordi Dunyach, à l'école d'Elna, s'est arrêtée au bout de quelques mois. Ramon a compris qu'il ne lui serait pas facile de récupérer sa langue catalane. Finalement, il a dû attendre la troisième année d'université, en 2001.Il a pu faire un Erasmus à Gérone, avec l'aide du professeur Miquel Leiberich car l'Université de Perpignan ne facilite pas les choses, et apprendre sa langue. L'apprentissage a été très rapide, car il avait la langue dans l'oreille et le cœur comme beaucoup de Catalans du Nord. Après trois mois de travail intensif, il donnait une conférence seul, devant une classe de Catalans du Sud pour leur expliquer sa Catalogne Nord.
Parler et écrire en catalan lui a permis de mieux comprendre son environnement et le monde. Malgré tout, être catalan continue d'être un combat et un apprentissage, jour après jour.En fait, nous avons tous une histoire et un arbre généalogique, mais le plus important est l'histoire que nous écrivons et notre militance pour les générations futures.
Retrouver son identité catalane n'est facile pour personne, surtout en France. Bizarrement, ce sont les catalanistes eux-mêmes qui vous compliquent la tâche. Quand on veut faire du catalanisme sans demander la permission à ceux qui voudraient en avoir le monopole et qui ont le soutien des institutions, c'est encore plus difficile. Ramon les appelle les « catalanistes alimentaires » et ne voit aucun intérêt à emprunter le même chemin, surtout quand il voit que leurs actions ne sont pas efficaces. Selon lui, le catalan appartient à tout le monde et chacun peut participer à sa manière à cette société nord-catalane en reconstruction, sans avoir à entrer dans un moule.
Histoire de mon grand-père, JOSEPH LABAT (1915-2009) :
cadre de la résistance en Béarn
Je viens de recevoir le livre « Résistances - Nay-en-Béarn » d’André Narritsens (édité en novembre 2015) où quelques pages sont dédiées à mon grand-père, JOSEPH LABAT (1915-2009), paysan, militant communiste d’avant guerre et l’un des principaux cadres de la résistance dans sa zone. Il faisait parti des Francs-tireurs et partisans (FTP) mouvement de résistance intérieure française créé à la fin de 1941 par la direction du Parti communiste français. Voici quelques extraits de ce livre qui font référence à mon grand-père :
- « Septembre 1943, la dislocation du groupe FTP marque la fin du premier « maquis ». Demeurent cependant sur place des militants autour desquels une activité politique va se poursuivre et, très bientôt, se construire une structure de lutte armée autour de Marcel Betbeder, Gabriel Borde, Henri Colin, Olivier Domenjeolles, JOSEP LABAT, André Lafourcade, Casimir Lagouare, Jean-Baptiste Lagouare, Jean-Marie Sarrès, Joseph Sarrès, Werner Waldeyer. Par-delà l’action propagandiste qui reprend peu à peu, d’autres signaux doivent être donnés qui, aussi symboliques qu’ils soient, indiquent clairement que l’action se poursuit. C’est sous ce prisme que doit être compris le sabotage effectué solitairement par JOSEPH LABAT, le 6 décembre 1943, contre une presse à fourrage à Pau. L’affaire fait quelque bruit ainsi qu’en témoigne l’importance accordée au sabotage par le Préfet, la police et les professionnels. » (p.182)
- « Le parachutage doit avoir lieu le 28 avril 1944 dans un vaste champs, près du village de Pardies-Pietat. L’opération se déroule sans problème particulier, hormis un retard de deux heures. Une vingtaine d’hommes (quinze FTP armés et cinq membres de Franc-Tireur et de Combat) sont présents ainsi qu’un technicien de l’AS venu des Landes. Les FTP assurent la sécurité sous la responsabilité de JOSEPH LABAT et participent au ramassage des containers. » (p.184)
- « Le lendemain les FTP sont informés que le dépôt risque d’être découvert. Dans la nuit du 2 mai, ils embarquent les containers dans un camion de l’entreprise Minvielle-et-Cabane, et se dirigent vers le village de Lys où JOSEPH LABAT a préparé de nouvelles caches. Le matériel réceptionné permet d’armer environ cent-vingt hommes. Il compte trois FM, deux bazookas, des mitraillettes sten, des fusils à canon court, des révolvers à barillet, des grenades à main et aussi un important matériel de sabotage. Une fois les notices en anglais décryptées, JOSEPH LABAT et Maurice assurent la première instruction. » (p.185)
- « Dans la nuit du 24 au 25 mai, à Nay, le Pont de fer est sévèrement détruit : l’opération a été réalisée par Maxime Boyrie, Louis Laborde et l’équipe de Lys dirigée par JOSEPH LABAT (50 kilos de plastic ont été utilisés). » (p.187)
- « La décision d’implanter une base rurale a suscité quelques débats. JOSEPH LABAT et le groupe FTP de Lys considèrent en effet qu’il faut poursuivre l’action à partir des principes de mobilité et de clandestinité antérieurs mais il est décidé de créer un centre opérationnel dans la ferme Pédy. » (p.189)
Le 12 juin 1944, le commandant Maurice, Joseph Labat, paysan de Lys et Marcel Betbeder de Mirepeix descendent à Nay avec leurs maquisards FTP pour appliquer la ligne donnée aux organisations de Résistance : s’affirmer, contrôler le territoire, préparer l’après Libération et le jugement des collaborateurs. Ils investissent la ville. Mais, en fin d’après-midi, une colonne allemande d’une soixantaine de soldats intervient. Au cours de l’accrochage, Maxime Boyrie et Jean Seignères tombent sous les balles de la colonne ennemie forte de soixante hommes environ. Puis Henriette Lascourrèges, Jeanne Lauga, Marie Mendez, ouvrières, et Pierre Cazaban, Charles Serville et Eugène Lacoste tombent sous les balles de l’armée d’occupation ou sont fusillés. Depuis la Libération, Nay fête chaque année cet épisode de la Libération.
- « Il est décidé à Lys de réalisé une action le 12 juin 1944 à Nay. Un jeune cycliste, Etienne Cazajous, a prévenu les FTP que des officiers allemands à la tête d’un convoi de plusieurs camions (trois, semble-t-il) sont en train de consulter une carte routière au carrefour des Quatre chemins. Cinq minutes après, une voiture bariolée de jaune surgit, suivie de trois camions. Théo Martin, vise la voiture et tire une demie-rafale mais le FM s’enraye. Les Allemands sautent des camions, s’aplatissent et commencent à tirer. Ils disposent d’une grande puissance de feu : des mitrailleuses et des mortiers sont fixés sur les camions et il semble qu’ils sont utilisés. Au bruit de ces premiers tirs, JOSEPH LABAT, Louis Le Bris, André Lafourcade et un quatrième FTP non identifié, en route pour effectuer un sabotage de la voie ferrée tente d’apporter un soutien au groupe des quatre. Ils lâchent quelques rafale de Mitraillettes avenue de l’école supérieure et Louis Le Bris est blessé (deux doigts sectionnés) après avoir lancé une grenade, JOSEPH LABAT décroche en zigzagant le long du cours Pasteur. Par chance les tirs allemands ne l’atteignent pas. Ses camarades fuient pas les jardins. Ce combat de Nay a fait 8 morts et 3 blessés. Les représailles allemandes seront très violentes. » (p.211)
- « Le groupe Vernet ayant participé à l’accrochage du pont d’Assat, s’est dirigé vers Lys et a sollicité Marie Labat, la femme de JOSEPH LABAT pour entreposer ses armes dans la ferme. Un refus a été opposé et conseil donné de camoufler les armes dans un champ de blé. Ce qui est fait. » (p.226)
- « Le 10 juillet 1944, le pont SNCF d’Aressy saute et quatre jours plus tard, JOSEPH LABAT et Jean-Baptiste Lagouare détruisent six pylônes à Arudy. Pour ces deux dernières opérations, en raison de la pénurie d’explosif on a dû recourir à la dynamite ou un dispositif à base de poudre noire/mèche. » (p.237)
- « Le 15 juillet, la voie ferrée de Toulouse-Bayonne, est sévèrement plastiquée : entre Montaut et la halte de Dufau, douze rails sont cassés, deux pylônes coupés et une caténaire affaissée. La circulation des trains est interrompue. Mais les partisans ont eu chaud : à l’opération terminée, des camions allemands surgissent. Y a-t-il eu dénonciation ? JOSEPH LABAT en est persuadé. » (p. 238)
- « Les arrestation de Lys (20 juillet 1944) : L’opération conduite dans le village se complète aux alentours de midi, d’une autre qui vise la ferme de JOSEPH LABAT où six personnes s’apprêtent à prendre leur repas. Trois d’entre elles (Henri Colin, son fils Riquet et André Lafourcade), résistants de vieille date planqués depuis quelques jours dans la ferme Bidot, son venus aider à la moisson du blé. Les deux autres, un jeune FTP nayais, Laurette, et un membre du groupe Franc-Tireur - que nous appellerons X - qui agit avec les FTP depuis le 12 juin, stationnent aussi dans la ferme. Peu avant que la soupe ne soit servie, on frappe à la porte. Le visiteur n’est autre que René Sarrat un ami d’un voisin de JOSEPH LABAT rencontré dans l’armée de l’Armistice, passé l’avant-veille à la ferme. Sarrat explique qu’il pense avoir, lors de sa visite, égaré son portefeuilles. Après quelques gestes de recherche, il quitte les lieux. La porte s’ouvre alors violemment laissant le passage à un officier et à des soldats allemands qui neutralisent les présents puis leur attachent les mains derrière le dos. L’officier déclare : « vous nous avez tué trois camarades ». Profitant de la confusion, Laurette parvient à s’enfuir.
Au total cinq personnes sont donc arrêtées (H. Colin, R. Colin, JOSEPH LABAT, A Lafourcade et X) et bientôt transportés en camion jusqu’à Lourdes. JOSEPH LABAT y est torturé deux jours durant puis, envoyé à Tarbes où les tortures reprennent. X est présent lors des séances de torture. Frappé au nerf de bœuf, il manque de suffoquer suite aux cinq ou six séances d’étouffement auxquelles on le soumet. Deux questions sont inlassablement répétées « qui sont vos chefs, où sont-ils ? ». JOSEPH LABAT ne lâche que des broutilles. Renonçant à obtenir d’avantage, les Allemands qui détiennent une liste de jeunes du village de Lys et entendent les appréhender embarquent cependant JOSEPH LABAT vers son village natal en compagnie de X. Ils sont conduits vers des lieux où la résistance FTP est supposée posséder des caches. Mais les fouilles auxquelles les Allemands se livrent ne donnent rien. » (p.241, 242)
« Trahison et tragédie (20 juillet-17 août 1944) : Après les arrestations de Lys, JOSEPH LABAT a été très surpris par la quantité de choses connues des Allemands. Ses soupçons se présisent bientôt lorsque, de retour d’une expédition vers les caches d’armes supposées des FTP, X demande à être « déposé [à Pontacq] », autrement dit relâché. Une trahison est en train de se révéler : X a parlé et compte sur la disparition de JOSEPH LABAT pour que son comportement reste inconnu. Plus tard, de retour à Nay, il déclarera que, convoqué à un interrogatoire, il a trompé la surveillance de son gardien et s’est évadé en sautant un mur.
En tout cas, pour l’heure, il disparaît et ne refera surface qu’à la Libération. Dans un contexte où JOSEPH LABAT est aussi revenu, celui-ci accuse X de trahison et les anciens dirigeants FTP décident de mettre celui-ci à l’écart jusqu’à ce que les évènements de juillet 1944 soient complètement éclaircis, ce qui ne peut être réalisé, X ayant souscrit un engagement dans le régiment de Bigorre. A l’automne 1945, en chemin pour l’Allemagne, il se tue à Sainte dans un accident de moto.
Les arrestations de Lys préludent également à une tragédie qui se déroulera le 17 août. En effet, après leur incarcération à Lourdes puis à Tarbes, A. Lafourcade, H. et R. Colin ont été transférés à la prison de Caffarelli à Toulouse. JOSEPH LABAT, pour ce qui le concerne, est incarcéré à la prison Saint-Michel où il se retrouve bientôt dans la même cellule qu’ANDÉ MALRAUX qui a décrit dans « Antimémoires » (1972) les conditions dans lesquelles leur libération de cette prison s’est déroulée avec l'aide des résistants.
Dans l’après-midi du 17 août A. Lafourcade et les Colin ont rendez-vous avec la mort avec 54 autres prisonniers extraits de divers lieux. Aux alentours de 17h30, arrachés à leur cellule puis poussés dans des camions bâchés. Amenés dans une grange, les soldats ont brûlés vif ceux qui n’était pas mort sous les rafales de mitraillettes. Pour atténuer les cris, les Allemands chantaient. Mais qui a donc constitué la liste des suppliciés, quels critères ont présidés à la sélection ? Quatre internés de la prison Saint-Michel échappèrent au massacre, dont JOSEPH LABAT. » (p.244)
Les Angelets de la Terra : héros mythiques de Catalogne Nord (1667 - 1675)
La Révolte des Angelets de la Terra : Une révolte nationale en Catalogne Nord
Introduction : Le cadre et l'importance de la révolte
Au XVIIe siècle, ce qui aurait pu être une simple insurrection antifiscale, comme tant d'autres, se transforma rapidement en une révolte pour préserver les droits et les libertés de la terre catalane. Le nom que se donnaient les insurgés était assez explicite : "els Angelets de la Terra". À cette époque, les Pyrénées catalanes avaient une importance stratégique durant tout le règne de Louis XIV. Il ne maintint pas le contrôle de cette nouvelle frontière en vertu du traité des Pyrénées, mais parce qu'il utilisa une force militaire et diplomatique supérieure à celle des Espagnols et réprima violemment les diverses tentatives de soulèvement catalan.
La révolte armée des Angelets de la Terra en défense des Constitutions catalanes et pour la réunification de la principauté de Catalogne, postérieure à l'infâme Traité des Pyrénées (1659), réussit à tenir en échec le tout-puissant Roi de France pendant plus de dix ans. Commandés dans le Vallespir par Josep de la Trinxeria, ils remportèrent de grandes victoires et écrivirent l'une des pages les plus héroïques et pleines de dignité de notre histoire.
Cependant, une fois de plus, nous sommes confrontés à des événements qui ne sont pas assez connus chez nous et, bien sûr, il y a aussi un manque alarmant de représentation iconique qui les maintienne présents comme un témoignage fier de l'ancestral esprit combatif de la nation catalane. De notre côté, il restera la tentative de restituer la mémoire de ces héros et de dénoncer ce manque de rigueur.
Partie 1 : Le Contexte Historique et les Causes de la Révolte
1.1. L'Annexion Française (1659)
Le 7 novembre 1659, suite à la guerre des Faucheurs (Segadors), les monarchies hispanique et française signèrent le Traité des Pyrénées, qui signifia le partage de la Catalogne entre les deux souverains. Ce traité a imposé une frontière qui annexe à la France le Roussillon, le Conflent, le Capcir et une partie de la Cerdagne. La résistance à l'occupation française de la Catalogne Nord commença dès mars 1661.
1.2. La Imposition de la Gabelle (1661) et la Trahison des Engagements
En juillet 1660, le Conseil Souverain du Roussillon est instauré, remplaçant la Diputació (Députation), confirmant en Catalogne Nord l'application officielle des Constitutions de la principauté de Catalogne que Louis XIV jura à Perpignan.
Cependant, les promesses sont rapidement brisées :
Juin 1660 :Suppression de toutes les institutions et organismes officiels catalans.
1661 :Imposition du monopole royal du sel, contraire aux Constitutions catalanes, impliquant la fermeture des salines locales et l'interdiction de transporter du sel d'autres salines de la Principauté.
Novembre 1661 :Rétablissement de la gabelle (taxe sur le sel), impôt abolie par les Corts Catalanes depuis 1283.
Conséquences et impopularité :
Cet argent devait servir à payer les troupes d'occupation et les fonctionnaires français, vus comme des "collaborateurs".
Détournement des fonds au détriment de Perpignan, considéré comme une abjuration du serment royal.
Protestations des consuls de Perpignan rejetées par le Conseil Souverain.
Cet impôt frappe particulièrement le Vallespir, pays de pâturages dépendant du sel catalan moins cher.
Début d'une contrebande intense et répression immédiate (exemple de Saint-Laurent-de-Cerdans en 1663 : 8 condamnations à mort, 51 aux galères).
Partie 2 : Le Déroulement des Révoltes
2.1. La Première Révolte (1667-1669) et le Compromis de Céret
Origine :En 1667, les gabelous fouillent les maisons de Prats-de-Mollo et imposent des amendes. Josep de la Trinxeria, membre d'une famille notable, indigné, organise la résistance armée.
Les Angelets :Une troupe de volontaires bien armés, aidés par les paysans, se baptise "Angelets de la Terra" (apparaissant et disparaissant comme des anges, ou en référence à Saint-Michel).
Actions :La guérilla s'étend dans le Vallespir. Ils attaquent une auberge de gabelous à Amélie-les-Bains et assiègent un sous-viguier dans une église. Le siège de Céret en 1668 est un point culminant.
Répression et échec français :Le président Sagarra mène une expédition punitive de 300 soldats, mise en déroute au pas del Llop.
Succès et négociation :La guérilla, connaissant bien le terrain, harcèle efficacement les troupes françaises. Louis XIV, engagé dans la Guerre de Dévolution, pactise le 24 avril 1669 par le "Compromis de Céret" : amnistie générale, suppression des gabelous et vente de sel à prix réduit.
2.2. La Seconde Révolte (1670-1675) et l'Écrasement
Relaîment :En 1669, Joan Miquel Mestre ("l'Hereu Just") exige le même traitement pour le Conflent. Son arrestation en janvier 1670 déclenche une nouvelle révolte.
Escalade :La révolte devient plus cruelle. Les Angelets s'emparent d'Arles (tuant le maire) et assiègent Céret une seconde fois avec 1500 hommes.
La défaite décisive :La France envoie une armée de 4 000 soldats qui prend le Vallespir à revers par les montagnes. Le 5 mai 1670, les Angelets sont défaits au col de la Regina, leur technique de guérilla étant inefficace en bataille rangée.
Répression exemplaire :Maisons et murailles de Prats-de-Mollo et Serralongue sont démolies. De lourdes amendes sont imposées à seize villages.
2.3. La Lutte dans le Contexte de la Guerre de Hollande (1672-1678) et les Complots
Collaboration avec l'Espagne :La lutte prend un caractère antifrançais assumé. Les Angelets collaborent avec la monarchie hispanique.
Le Complot de Villefranche (1674) :Visant à une réunification avec la Principauté de Catalogne lors du Samedi Saint 1674. La conspiration est découverte.
Répression Terrible :
Le chef Manuel Descatllar est torturé, exécuté et sa tête exposée.
Francesc Puig i Terrats est égorgé en public et son corps démembré.
Les têtes des chefs Angelets sont exposées dans des cages de fer pendant 30 ans.
Spoliation des biens des accusés. Le village de Py est rasé et du sel est semé sur ses ruines.
Purge sociale : exils (plus de 200 personnes) et exécutions (une centaine).
Derniers soubresauts :Les troupes espagnoles prennent le Fort de Bellegarde et contrôlent une partie de la Catalogne Nord (1674) avant d'en être chassées en 1675. La révolte est considérée comme terminée cette année-là. Les haines et le coût de la répression sont tels que Louis XIV tente d'échanger les Comtés nord-catalans contre la Flandre, sans succès.
Partie 3 : Analyse, Mémoire et Débats Historiographiques
3.1. Qui étaient les Angelets ? Organisation et Soutien Populaire
Origine sociale :Paysans, muletiers (premiers affectés), travailleurs des forges ("clavataires", un groupe cohérent qui prit le leadership), quelques nobles, femmes (soutien passif), enfants et adolescents (espionnage).
Organisation et tactique :Corps armé organisé techniquement, suivant les systèmes d'autodéfense du pays (sometents, miquelets). Excellente connaissance du terrain, armement léger, grande mobilité. Cri de ralliement : « Via fora lladres i gavatxs! » (« Dehors les voleurs et les gabelous ! ») et « Visca la Terra » (« Vive la Terre »).
Soutien populaire :La bienveillance et la complicité des populations représentaient un soutien passif crucial. Sans ce soutien actif et passif, leur longévité n'aurait pas été possible.
3.2. Le Débat : Révolte Antifiscale ou Nationale ?
Une interprétation évolutive :Le début du mouvement est une réaction à une décision politico-fiscale. Mais avec le temps et l'implication d'acteurs divers, l'interprétation de la révolte évolue.
Une "nation fragmentée" :La solidarité ne fut pas générale. Il s'agissait d'une consolidation du sentiment identitaire par zones affectées, une "contre-identité" face à l'agression française prolongée.
Un choix politique :La révolte devient une décision politique d'identité nationale, une préférence pour la monarchie hispanique face à l'impossibilité de l'auto-affirmation.
La perception française :Pour la France, cette révolte était plus qu'antifiscale ; elle représentait un danger sécessionniste, un "pont pour l'invasion de l'ennemi". Cela explique l'envoi de grands contingents militaires et la méfiance durable des autorités.
3.3. La Mémoire, l'Oubli et la Représentation
Une histoire oubliée :Ces faits sont absents des manuels scolaires et presque inconnus de l'historiographie française.
La récupération historique :Philippe Torreilles a redécouvert cette histoire au début du XXe siècle.
La représentation iconographique erronée :Le portrait de Josep de la Trinxeria, peint en 1726, le montre vêtu à la mode de 1726, et non de son époque, ce qui est typique des portraits familiaux posthumes et démontre un manque de rigueur.
Appel à la mémoire :Il serait "impardonnable" que ces héros, derniers défenseurs des libertés catalanes en Catalogne Nord, tombent dans l'oubli.
3.4. Portrait et Postérité de Josep de la Trinxeria
Le chef charismatique :Membre d'une famille bourgeoise de Prats-de-Mollo, il consacra sa vie à la réunification. Il jouissait d'un grand prestige et fut l'un des promoteurs du complot de Villefranche.
Fin tragique :Il mourut au combat en 1689 lors d'une incursion depuis sa base d'Olot, où il était réfugié. Il avait reçu une patente de colonel de Miquelets de l'Espagne.
Restitution rigoureuse de son apparence :Basée sur une description de 1673 : habit de drap foncé avec un galon d'argent, chapeau à la française, cheveux longs, moustache retroussée.
L'Intérêt Historique et la Signification Profonde
Quel intérêt peut avoir cette révolte pour les historiens d'aujourd'hui ? Sa signification apporte des données sur l'adscription politique et sociale plus révélatrices que son seul contenu politique.
La vision extérieure (de la France) est cruciale : elle a perçu la révolte comme un danger réel, ce qui a conduit à une répression brutale et à un renforcement du contrôle militaire de la frontière (comme à Mont-Louis).
Conclusion finale : L'extension et la durée du conflit ont solidifié une idéologie. Ce ne fut peut-être pas la représentation d'une nation construite, mais bien "l'expression de l'identité propre face à l'autre qui est rejetée". La Révolte des Angelets créa un précédent capital dans les relations entre Roussillonnais et Français et marqua durablement les mémoires.
Contexte
1659 : Annexion française de la Catalogne NordLe 7 novembre 1659, suite à la guerre des Faucheurs (Segadors), les monarchies hispanique et française signèrent le Traité des Pyrénées, qui signifia le partage de la Catalogne entre les deux souverains. Ce traité a imposé une frontière qui annexe à France le Roussillon, le Conflent, le Capcir et une partie de la Cerdagne. La résistance à l'occupation française de la Catalogne Nord commença dès mars 1661.
1661 : La gabelle, impôt sur le sel en Catalogne NordEn juillet 1660, le Conseil Souverain du Roussillon est instauré, remplaçant la Diputació (Députation), confirmant en Catalogne Nord (le Roussillon, le Conflent, le Vallespir, le Capcir et le nord de la Cerdagne) l'application officielle des Constitutions de la principauté de Catalogne que Louis XIV jura à Perpignan, comme les avait jurées auparavant Louis XIII, et tous ses vice-rois, et confirmées par des édits royaux à Paris. Malgré tout cela, l'année suivante, le monarque français impose le monopole royal du sel, contraire aux Constitutions catalanes, ce qui implique la fermeture des salines locales et l'interdiction de transporter du sel d'autres salines de la Principauté comme celle de Cardona. Les protestations contre cet outrage sont généralisées et la révolte est réprimée avec une grande cruauté. Pour couronner le tout, le royaume impose un nouvel impôt aux Catalans, la gabelle du sel, pour entretenir les troupes d'occupation. Louis XIV s'était engagé à maintenir les institutions catalanes, mais en juin 1660, il supprime toutes les institutions et organismes officiels, les remplaçant par de nouvelles formes administratives et fiscales. La résistance au nouveau maître commença en mars 1661. Étant venu résoudre un conflit entre les habitants d'Aiguatèbia et ceux d'Orellà, le Viguier Marsal fut violemment attaqué. Il réussit à s'enfuir, mais l'avocat et le serviteur qui l'accompagnaient sont assassinés. Dans le sud de la France, une viguerie était un tribunal administratif médiéval. Au mois de novembre 1661, il établit la gabelle, taxe sur le sel abolie par les Corts Catalanes (les Cours Catalanes) depuis l'année 1283, sous le roi Jacques II de Majorque. Cet argent devait servir au paiement des dépenses des places fortes et des soldes des fonctionnaires français, entre autres les paiements aux magistrats du Conseil Souverain. De cette manière, l'impôt devait avoir un surcroît d'impopularité, puisqu'il subventionnait ceux qui, aux yeux de la population autochtone, étaient des « collaborateurs ». La mesure est très impopulaire. Le détournement par le roi de France du montant de cet impôt - au détriment de Perpignan, qui n'en reçoit qu'une partie insignifiante - est considéré comme une abjuration du serment royal de respecter les privilèges de la capitale de la comarque du Roussillon. Les consuls de Perpignan protestent. Mais une décision du Conseil Souverain rejette la plainte municipale et impose la volonté du gouvernement. Cet impôt frappe de front les habitants du Vallespir, pays de pâturages, habitués à acheter du sel catalan qui venait de l'autre côté de la nouvelle frontière. Alors commence une contrebande intense que tentent d'interrompre les gabelous, un corps de gardes fonctionnaires chargés de contrôler le commerce du sel, en fouillant notamment les maisons et les chargements des muletiers. Disons en passant que cela signifiait que des zones comme le Vallespir ignoraient encore la nouvelle frontière. La France ne disposait pas encore vers 1662 d'une garde frontalière vraiment efficace ni d'une infrastructure militaire suffisante pour contrôler tous les mouvements transfrontaliers. En 1663, les habitants de Saint-Laurent-de-Cerdans se révoltent contre les gabelous qui ont emprisonné certains muletiers, et les détruisent. La répression, à la charge du Président du Conseil Souverain, Francesc Sagarra, un catalan renégat, est immédiate : huit habitants sont condamnés à mort et cinquante et un aux galères à perpétuité. Mais la contrebande continue, plus forte que jamais.
1667-1668 : La première révolte des Angelets de la TerraLes Angelets de la Terra agirent surtout entre 1667 et 1675 comme de véritables guérilleros contre les troupes françaises et surtout contre les fonctionnaires de la gabelle du sel, qui entravaient la gestion des contrebandiers du sel. En 1667, les gabelous fouillent les maisons de Prats-de-Mollo, imposant une série d'amendes aux habitants trouvés en possession de sel "espagnol". Parmi eux se trouve Josep de la Trinxeria, membre d'une des plus anciennes familles de la ville. Indigné par le manque de respect des Usatges Catalans (Usages de Catalogne), il décide d'organiser une résistance armée. Peu de temps après, Josep de la Trinxeria réunit une troupe de volontaires bien armés et disciplinés, aidés par les paysans, ils s'autoproclament les Angelets de la Terra. Leur nom viendrait de la facilité avec laquelle ils apparaissaient et disparaissaient, tels des anges. D'autres versions lient l'origine du nom à l'archange Saint Michel, patron des paraires (drapiers) de Prats-de-Mollo. La guérilla des Angelets se répandit dans la comarque du Vallespir, cachés surtout dans les villages de Serralongue et Montferrer en 1667. Damià Nohell, connu pour être le fils du maire de Serralongue, et plus tard Joan Miquel Mestre de Vallestàvia, dit l'Hereu Just (l'Héritier Juste) de Vallestàvia, furent quelques-uns des lieutenants de Trinxeria. En 1668, ils attaquèrent l'hôtel des Bains où logeaient les gabelous. Ils assiégèrent aussi dans l'église de Saint-Laurent-de-Cerdans un sous-viguier nommé Maniel. Symboliquement, l'effet du siège des Angelets à Céret en août 1668 signifia un point culminant dans la lutte. En réponse, Francesc de Segarra offrit en juillet une récompense de cent doublons d'or à qui arrêterait les résistants et en septembre, il y alla avec une expédition punitive de 300 soldats. L'expédition, cependant, fut vaincue au pas del Llop (col du Loup). Sagarra, poursuivi par ses vainqueurs, s'enferma dans Arles.Lettre de Louvois à Macqueron, à Paris le 11-11-1668 (Louvois faisait preuve de fermeté avec ces ordres et mettait sur le même plan les révoltés armés que les populations qui refusaient le paiement de l'impôt ou développaient la contrebande ou donnaient refuge aux rebelles ; qu'il s'agisse de révoltés actifs ou passifs, puisque dans les deux cas on contrevenait au roi) :« Obliger les lieux d’où la gabelle a été chassée à la recevoir de nouveau, et à livrer les coupables entre les mains de la justice; sinon entrer de force dans ces montagnes, piller et brûler quelques villages, qui soit une marque à ces gens là de leur punition, et donne un exemple aux autres sujets du Roy du mesme pays qui les empesche de tomber dans les mesmes inconvenients. »(Forcer les lieux d'où la gabelle a été chassée à la recevoir à nouveau, et à livrer les coupables entre les mains de la justice ; sinon entrer de force dans ces montagnes, piller et brûler quelques villages, qui soit une marque pour ces gens-là de leur punition, et donne un exemple aux autres sujets du Roy du même pays qui les empêche de tomber dans les mêmes inconvénients.)Bons connaisseurs du territoire, les guérilleros nuisirent gravement aux troupes françaises durant ces années, poursuivant et éliminant un bon nombre de collecteurs de l'impôt sur le sel. Louis XIV, engagé dans une nouvelle guerre contre l'Espagne (Guerre de Dévolution : 1667-1668), se résout à pactiser avec les Vallespiriens le 24 avril 1669. Ce pacte, appelé le compromis de Céret, consiste en une amnistie générale, la suppression des gabelous et la vente du sel à un prix plus bas aux municipalités du Vallespir.
1670-1675: La seconde révolte des Angelets de la TerraEn 1669, étant l'un des chefs de la révolte, Joan Miquel Mestre « l'Hereu Just » exigea le même traitement pour le Conflent. Il fut arrêté le 22 janvier 1670 par le gouverneur de Prats-de-Mollo, ce qui généra la révolte des voisins de la localité qui prirent sa femme et ses enfants en otages. Ceux-ci furent échangés contre l'Hereu Just, qui put ainsi s'échapper. Les Angelets réussirent à expulser les Français de Prats-de-Mollo en janvier 1669 et y restèrent jusqu'au mois de mai. À ce moment-là, la révolte non seulement recommença mais fut beaucoup plus cruelle et les luttes eurent lieu dans tout le Vallespir : Le 27 février 1670, les Angelets s'emparèrent d'Arles en tuant le maire. Peu après, 1500 Angelets assiégèrent pour la deuxième fois Céret, la capitale du Vallespir, entre le 31 mars et le 2 avril. À partir de là, les Français envoyèrent une grande armée de 4 000 soldats dans les montagnes qui séparent le Conflent et le Vallespir pour attaquer cette dernière comarque par les arrières, évitant ainsi d'être une cible facile via la route de la vallée. Le 5 mai, ils vainquirent finalement les Angelets au col de la Regina, car la technique de guérilla ne pouvait faire face à une armée complète dans une bataille ouverte. Quelques Angelets se réfugièrent en Catalogne Sud et d'autres se cachèrent dans les montagnes pour poursuivre des actions de guérilla, mais on peut dire qu'à partir de cette défaite, la grande révolte des Angelets de la Terra est vaincue. Les Angelets venaient principalement de la Catalogne Sud et du Haut Vallespir ; en moyenne, un homme par maison, ce qui montrerait l'exceptionnalité de l'affaire, puisqu'il ne s'agissait pas d'une assistance armée obligatoire. La réaction française n'envisageait déjà aucun type de négociation et il fallait donner un certain sens d'exemplarité à la réponse : le 21 juillet 1670, Francesc Martí Viladamor (Conseil Souverain) exigea la démolition de certaines maisons et des murailles de Prats-de-Mollo et de Serralongue, en plus d'établir une liste d'amendes pour les populations de la zone — seize.
C'est la seule image de Josep de la Trinxeria qui est conservée. Huile réalisée sur commande, avec une autre de son fils Blai, en 1726. Tout porte à croire qu'elle a été commandée par lui. (Musée Can Trincheria, Olot)
1674 : Complots de Villefranche, Perpignan et CollioureLes hostilités se prolongèrent encore pendant quelques années, étant importantes durant la guerre entre la France et la Hollande entre 1672-1678. Vers les années 1672 et 1673, devant la plus que probable guerre franco-espagnole, certains notables perpignanais entrèrent en contact avec les chefs de la révolte en leur demandant de tenir le plus longtemps possible. De cette manière, on espérait que l'union de la guerre et de la révolte permettrait une intervention espagnole et la réunification du pays. Le village et l'église d'Aiguatèbia furent brûlés par les troupes françaises le 7 février 1673. La lutte prit un caractère de soulèvement antifrançais et ainsi les Angelets collaborèrent avec la monarchie hispanique. Ils intervinrent dans le complot de Villefranche-de-Conflent pour tenter de réunifier les Comtés à la Catalogne. Les quelques familles notables du pays qui restaient avaient tenté de participer à un complot contre la France. Le samedi saint de 1674, Villefranche avec ses autorités devait se soulever et, depuis la Principauté, des Miquelets et des troupes castillanes devaient entrer par la Cerdagne. Perpignan et Colliure devaient aussi se révolter. La conspiration fut découverte et son leader, Manuel Descatllar i Dessoler, fut arrêté et transféré à Perpignan, reconnaissant tous ses actes sous la torture, et exécuté sur la place de la Loge le 2 avril 1674. La tête de Manuel Descatllar fut pendue aux portes de Villefranche-de-Conflent. En revanche, son compagnon Francesc Puig i Terrats fut condamné à mort et décapité en public devant sa propre maison. Son corps fut démembré et les quatre parties exposées aux quatre points de la ville. À partir de ce moment, les arrestations et exécutions deviennent habituelles. Beaucoup d'autres conspirateurs payent leur engagement par la perte de leurs droits civils et patrimoniaux. Josep de Trinxeria et Carles de Banyuls qui devaient soulever à nouveau le Vallespir s'exilèrent en Catalogne Sud. La répression fut très dure : À titre d'exemple, soulignons que la population de Py qui avait soutenu les Angelets fut condamnée à être totalement rasée et à semer du sel sur ses ruines. Les chefs de la révolte qui furent arrêtés, comme Manuel Descatllar (26 ans), Francesc Soler (consul de Villefranche), Carles de Llar, Francesc Puig i Terrats, reconnurent tous leurs actes et, coupables de crime de lèse-majesté, furent jugés, torturés et exécutés. Une fois morts, étranglés, les têtes des Angelets furent exposées dans des cages de fer aux portes d'entrée de Villefranche-de-Conflent et de Perpignan pendant 30 ans. Les biens de tous et chacun des accusés furent spoliés par l'état. La terreur continua pendant tout le siècle. Ces faits appartiennent à notre histoire et nous ne pouvons ni ne voulons les oublier ; et malheureusement, ils ne figurent pas dans les manuels scolaires. Comme il avait eu connaissance des mouvements de troupes espagnoles, l'officier français expliquait à Louvois que le vice-roi de Catalogne avait mobilisé entre dix et douze mille soldats, avec l'espoir de profiter du soulèvement interne de Villefranche-de-Conflent. Il faut souligner la participation dans ces manœuvres contre les autorités françaises d'une certaine élite roussillonnaise : « […] il a paru dans cette occasion peu d’affection pour le service du Roy dans les peuples de païs cy: il avoit a craindre mesme que la conspiration n’allat assez loing pour couper la gorge à toutes les troupes dans les quartiers quoy qu’elles ayent tousjours vécu avec le meilleur ordre du monde, Je vous asseure que cette affaire a esté fort grande et que sy jeusse manqué a la destourner comme jay fait de loing, les suittes pouvoient estre tres fascheuses. »([…] il a paru dans cette occasion peu d'affection pour le service du Roy dans les peuples de ce pays-ci : il y avait même à craindre que la conspiration n'allât assez loin pour couper la gorge à toutes les troupes dans les quartiers quoiqu'elles aient toujours vécu avec le meilleur ordre du monde, Je vous assure que cette affaire a été fort grande et que si j'eusse manqué à la détourner comme j'ai fait de loin, les suites pouvaient être très fâcheuses.)La répression fut grande et les interrogatoires, longs et détaillés. Comme toujours, l'idée de marquer l'exemplarité fut l'un des objectifs. Pour Le Bret, la difficulté la plus grande une fois la conspiration découverte était d'obtenir des témoins réels, et pas seulement ceux provoqués par la torture. Il considérait que les peuples impliqués, les gens du pays, maintenaient un fort lien et que, comme dans le cas des Angelets, il ne serait pas facile de les dénoncer. Ainsi disait-il dans une lettre envoyée à Louvois le 7 avril : «On auroist besoing en ce païs cy d’un bon furet pour découvrir tous les complices, Il n’est pas croyable la consternation qu’il y a parmy tout ce peuple-cy: depuis que cette affaire a marqué assurément».(On aurait besoin en ce pays-ci d'un bon furet pour découvrir tous les complices, Il n'est pas croyable la consternation qu'il y a parmi tout ce peuple-ci : depuis que cette affaire a marqué assurément.)Ainsi, une fois encore, ce serait le tour de certains membres du Conseil Souverain de mener les enquêtes, ce qui renforcerait une fois de plus la distance entre l'institution et le peuple. De fait, ils trouvèrent une taupe en la personne d'un jeune étudiant de vingt ans qui confessa ce qu'il savait en échange d'une amnistie personnelle. Carlier reconnaissait que «sa déposition m’est d’un grand secours». D'une certaine manière, l'aspect principal dont les Français se rendaient compte qu'ils devaient contrôler, parce que sinon les choses pouvaient leur échapper des mains, étaient les rumeurs et l'opinion publique. Les autorités connaissaient les relations de certains conspirateurs avec certaines personnes de la Principauté, ce qui était préjudiciable par l'intoxication que cela pouvait provoquer parmi les peuples du Roussillon. L'intendant se montrait préoccupé devant l'idée que les Espagnols profitent de la guerre et des faits du Roussillon pour «exciter une révolte dans tout le pays». De son côté, Le Bret se montra encore plus belliqueux sur ce sujet et alerta que ceux d'Espagne avaient «Intelligence avec les peuples du Roussillon». De fait, il exprimait clairement sa méfiance envers les gens du pays et, aussi, le préoccupait le fait que l'on fasse croire aux gens qui vivaient près de la frontière que les Français étaient sur la défensive et que viendraient d'importantes troupes d'Espagne. Finalement, il définissait la situation que l'on vivait comme : «L’opinion du bruit». C'est-à-dire, il était conscient de l'importance de contrôler les canaux d'information — quel qu'ils soient —, puisque la population semblait être prédisposée à se joindre à une nouvelle conspiration si les Espagnols réussissaient à pénétrer dans ce territoire. À part les mesures belliqueuses (augmentation de troupes et constructions militaires), la principale réaction des autorités françaises fut la purge de ceux qui s'étaient montrés contraires à la France à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, les exécutions et les exils — forcés et volontaires — furent nombreux. Certains historiens, comme Josep Sanabre, considèrent que la répression fut brutale et généralisée. Ainsi dit-il : «no es reduí a castigar unes quantes famílies d’aquella població [Vilafranca], ans tingué repercussions en d’altres llocs del Rosselló, fins a la mateixa capital».(Elle ne se réduisit pas à punir quelques familles de cette population [Villefranche], elle eut au contraire des répercussions en d'autres lieux du Roussillon, jusqu'à la capitale elle-même.)
La répression aurait continué pendant la guerre, au moins jusqu'en 1676, date à laquelle Beaulieu commente la possibilité de mettre en pratique un projet d'amnistie générale pour les conspirations du Roussillon de 1674. Le chiffre qu'il nous offre d'exilés dépasse facilement les deux cents personnes. À cela, il faudrait ajouter la centaine de personnes réprimées et condamnées à mort. Tenant compte que souvent ces personnes partaient avec toute la famille, le nombre fut vraiment énorme. En revanche, Alain Ayats laisse entendre que si les exils furent nombreux, ils ne furent pas massifs. De fait, il se réfère au fait que les adhésions aux révoltes ne se généralisèrent pas et furent limitées. En même temps, il met en doute qu'il s'agisse d'un sentiment national, puisque la solidarité ne fut pas générale partout. Or, grâce à cette interprétation, nous pouvons entrer de plain-pied dans l'idée de la « nation fragmentée », c'est-à-dire la consolidation du sentiment identitaire par zones affectées : le passage de la communauté ethnique à la nation — sens contemporain — ne pouvait se faire de la même manière dans toutes les zones du pays ; apparaît ici la figure de la contre-identité face à l'agression à long terme. Évidemment, ces conflits ne peuvent s'observer de manière microterritoriale, mais on ne peut pas non plus prétendre que de l'autre côté de la Catalogne il y avait un fort sentiment de solidarité généralisé (surtout depuis Barcelone), tenant compte que depuis vingt ans on n'y subissait plus aucune guerre ni aucune agression française. Aussi, en évaluant la rapidité des arrestations et le caractère de la répression (avril-juin 1674), comment les populations pouvaient-elles s'adhérer sans aucune sécurité à un quelconque soulèvement contre la France ? Et c'est que, de fait, les complots n'étaient plus un mouvement antifiscal, mais une décision politique d'identité nationale — avec toutes les nuances de l'époque que cela impliquait — ; principalement, une adscription préférentielle à la monarchie hispanique. Ainsi donc, les paysans pouvaient avoir moins de motifs de se révolter : par peur des répressions et, possiblement, par manque de motifs explicites, comme l'étaient les fiscaux. Pour cette raison, donc, les officiers français craignaient les mouvements espagnols et l'effet que leur propagande pouvait faire parmi la population : comment auraient réagi les habitants si réellement les troupes hispaniques étaient entrées en Roussillon, de manière continue et crédible ? C'était le grand doute des autorités galloises (françaises) et des profrançais eux-mêmes, étant donné que certaines de ces redoutées réactions semblent effectivement s'être produites, comme durant le mois d'août 1674. Le maréchal Schomberg confirmait l'adhésion des populations voisines à la troupe espagnole, expliquant que les Espagnols se maintenaient forts au château de Montesquiu avec seulement cinquante hommes, grâce au soutien logistique offert par les habitants : «Il est vray qu’il [l’enemic] a de grands avantages sur nous ayants tous les Peuples pour luy, et nous ne pouvons pas fer aucun mouvement sans qu’il en soit averty […] Cette Infidélité s’estend mesmes jusques sur le Régiment du Comte d’Ille, dont les meilleurs hommes qui sont de ce pays cy se sont allés rendre despuis peu».(Il est vrai qu'il [l'ennemi] a de grands avantages sur nous ayant tous les Peuples pour lui, et nous ne pouvons faire aucun mouvement sans qu'il en soit averti […] Cette Infidélité s'étend même sur le Régiment du Comte d'Ille, dont les meilleurs hommes qui sont de ce pays-ci se sont allés rendre depuis peu.)Possiblement, les années qui suivirent les conspirations de 1674 furent un point d'inflexion dans la relation franco-catalane en Roussillon et dans l'intérêt de l'établissement de la France dans ce territoire. Les Français découvrirent que le manque d'affection de la population pouvait se retourner contre eux et il fallait trouver une solution, en pleine époque de guerre. La confirmation de leur intérêt pour les comtés, les oppositions naissantes, la guerre avec l'Espagne et l'opportunité de la frontière pyrénéenne dans les tables militaires amenèrent à réaliser une purge sociale qui, symboliquement, n'avait pas eu lieu depuis les années quarante. Curieusement, ce sont les mêmes Catalans profrançais qui s'chargent de mener à bien cette politique, bien que les ordres viennent de la cour française. Les Catalans qui gouvernaient en Roussillon se trouvèrent dans une situation unidirectionnelle, puisque, sans possibilité de retour, la méthode d'ascension sociale et de maintien patrimonial était la soumission totale à la France, passant par-dessus leurs propres compatriotes. Les fortifications étaient, donc, un élément de plus lié aux révoltes et aux conflits du Roussillon : si on ne pouvait couper les échanges d'information familiaux et humains, la barrière militaire devait le faire. Nous ignorons si réellement elle y parvint, mais, en tout cas, elle exerça une véritable méthode de dissuasion. À quoi était due la relation que les Français observaient entre les populations du pays et la monarchie hispanique ? L'affinité élective de certaines zones des comtés pour l'Espagne pourrait être comparée à celle que la Catalogne eut pour la France en 1640 (ce qui amena aussi la monarchie espagnole à exercer une répression et un contrôle intérieur depuis les années cinquante, par peur des non-inscrits et pour démontrer le poids du pouvoir central). Cela n'indique, cependant, ni le degré d'affection des Catalans du Roussillon pour les Espagnols, ni qu'il n'existait pas un renforcement de l'identité propre dans ces endroits où les conflits étaient plus forts et temporellement plus étendus et, par conséquent, on ne peut affirmer une théorie empirique sur le cas. Dans les années postérieures, tous ces conflits eurent des effets concrets : un rejet croissant du traitement des autorités envers les peuples immergés dans les soulèvements et, en contrepartie, l'enracinement d'une méfiance française face à de nouvelles possibles révoltes, mais non plus parce qu'elles étaient antifiscales, mais pour ce qu'elles représenteraient de sécessionnistes — antifrançaises et en faveur d'un retour en faveur de l'Espagne (cela toujours aux yeux de la France) —. Évidemment, jusqu'à quel point ceux qui avaient participé à une révolte ou une autre espéraient-ils réellement l'aide espagnole ? Nous croyons qu'avec le temps et les contacts des chefs de la Révolte des Angelets — Trinxeria —, par exemple, la stratégie finale menait vers une intervention de l'armée hispanique. Il était mis en évidence, comme l'historiographie — concordante pour une fois — a amplement démontré, une solidarité de voisinage et communautaire semblable à une conscience identitaire collective face au Français, puisque l'agression (fiscale et militaire) dépassa le fait ponctuel et l'anecdotisme et perdura pendant plus de cinquante ans. Cette réaction, cependant, montrait-elle le choix d'être dans la monarchie espagnole plutôt que dans la française ? C'était un choix d'identité politique à travers une affirmation d'identité collective : la préférence devant l'impossibilité de l'auto-affirmation. De la même manière, la peur qu'avaient les Français se convertit en méfiance et en un augment du contrôle : les zones par où pénétraient plus facilement les troupes espagnoles, la Cerdagne et le Conflent, devinrent un territoire presque fortifié et de conquête impossible pour les Espagnols — d'où la fonction de Mont-Louis. La révolte fut plus qu'une question de mécontentement antifiscal pour la France. S'il est vrai que d'autres soulèvements de racine semblable avaient amené le chaos dans d'autres zones du royaume (Bretagne, Languedoc), aucun ne s'était caractérisé par devenir un pont pour l'invasion de l'ennemi, puisque les révoltés embrouillaient les forces françaises. Cela ne voulait pas dire, cependant, que les habitants des comtés préféraient les Espagnols aux Français. Les troupes du roi d'Espagne franchirent la frontière et prirent le Fort Bellaguarda (début 1674). Elles contrôlèrent une grande partie de la Catalogne Nord (Cerdagne et Vallespir, partie du Roussillon et du Conflent). Ce ne fut qu'en 1675 que le comte de Schomberg reprit Bellaguarda et les expulsa définitivement. La Catalogne Nord fut envahie par les troupes royales et la répression toucha toute la population : emprisonnements, condamnations aux galères, exécutions, confiscation de biens, amendes radicales aux municipalités (celle de Prats-de-Mollo fut de 3 500 livres, celle de Sant Llorenç de 1 600...). La révolte est considérée comme terminée en 1675. Les haines et le coût de la répression atteignirent un tel point que le monarque français tenta d'échanger les Comtés nord-catalans contre la Flandre, mais le roi espagnol s'y refusa. La révolte complètement achevée, le roi de France renonça à cet échange durant les négociations du traité de Nimègue, qui mit fin, en 1678, à la guerre de Hollande.
Conclusions
Quel intérêt peut avoir cette révolte pour les historiens d'aujourd'hui ? En premier lieu, sa signification peut apporter des données et des interprétations d'adscription politique et sociale bien plus révélatrices que son contenu exclusivement politique. C'est-à-dire, ce que les révoltés pouvaient penser, ou ce pour quoi ils croyaient se révolter contre les autorités — en dehors du fait que le motif ait pu évoluer avec les années —, pouvait avoir un poids moins important que l'interprétation qu'en faisaient les puissances européennes, parmi elles les directement impliquées furent la France et l'Espagne. S'il y a eu un débat sur le caractère national ou antifiscal — ou les deux choses — de la Révolte des Angelets, on a rarement cherché à faire abstraction et à essayer de découvrir comment fut perçue la rébellion depuis le nouveau centre politique français. C'est-à-dire, il serait convenable de tracer les ponts entre le signifié et le signifiant de la révolte et de ce qui l'entourait. De notre côté, nous entendons que le début du mouvement fut dû bel et bien à une réaction de la population contre des décisions politico-fiscales, même si à long terme l'interprétation de la révolte elle-même pouvait évoluer. Les exemples qui en découlent sont, par leurs caractéristiques, didactiques pour arriver à comprendre la cohésion autochtone face à un ennemi commun et persistant, mais en aucun cas empiriques et représentatifs d'une identité globale quelconque. Les terres du Roussillon sont certes un cas adéquat pour prêter attention à ces observations. Pouvons-nous penser, donc, que cet impôt de la gabelle et ses effets furent suffisants pour déboucher sur une révolte ? Avec les questionnements de conscientisation identitaire que la guerre avait provoqués, le rejet global du Français dans les Pyrénées catalanes se consolida et, si la révolte avait effectivement un caractère antifiscal, l'intermédiation d'acteurs qui provenaient de mondes divers — muletiers, miquelets, paysans, nobles, chapelains — accordait un esprit général au mouvement. Cependant, comme il arrive souvent, les uns commandaient et les autres suivaient. De la même manière, cependant, nous pouvons comprendre que la bienveillance et la complicité des populations avec les révoltés représentaient une sorte de soutien passif à la rébellion, puisqu'il s'agissait de gens du peuple ou d'un comportement contre l'État. Quel serait, donc, cet État centralisateur ? La population avait-elle assez conscience pour définir et distinguer entre le type d'état, l'ennemi et le compatriote ? En effet, c'étaient des personnes du pays qui luttaient contre un ennemi commun. En tout cas, comme nous disions au début, il sert à peu d'adopter une interprétation historique ou une autre, puisque la vision extérieure — de ceux qui détenaient le pouvoir : la France — pouvait avoir un poids plus grand et apporter des données nouvelles sur ce que cette révolte a réellement signifié pour eux. Cependant, pour comprendre la relation de ces interprétations avec les faits qui se sont produits, il est nécessaire d'observer les moments clés de ce conflit. Ainsi, avec les premiers incidents qui eurent lieu à Saint-Laurent-de-Cerdans, au mois d'avril 1663, commença la persécution du commerce converti en contrebande et, donc, l'arrestation de muletiers du sud et du nord des Pyrénées. Le visiteur général de la gabelle initia les arrestations qui provoquèrent une réaction en chaîne d'arrestations et de vengeances, certifiées avec l'assassinat de tous les gardes de la gabelle qui se déplaçaient sans protection. De leur côté, le Conseil Souverain réagit en envoyant à Arles son président, Francesc de Sagarra, et le conseiller Francesc Martí Viladamor. Les formes et manières violentes de Sagarra étaient déjà assez connues et « réputées » alors. Il est intéressant de remarquer qu'à partir de ce moment, les travailleurs des forges se joignirent aux révoltés et que les universités locales n'entreprirent aucune action légale contre les rebelles. La terreur développée par la répression sagarrienne motiva les accords et les solidarités entre beaucoup de peuples, selon l'étude d'Evelyne Erre-Masnou et Maryse Espin. Ainsi, par exemple, durant le soulèvement de Saint-Laurent-de-Cerdans en mai 1663, les habitants de localités voisines comme Serralongue, Coustouges, Maureillas-las-Illas et Taillet y arrivèrent quelques heures plus tard en entendant les cris de secours. Selon Erre Masnou et Espin, les acteurs principaux de la révolte jusqu'en 1665 furent des paysans qui, de manière plus ou moins spontanée, prirent les armes contre l'oppression économique et sociale, sans aucune sorte d'organisation, si ce n'est la connaissance du territoire comme avantage face aux soldats. Le sentiment de solidarité aurait permis aux habitants de se protéger, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une réaction d'autodéfense : « via fora lladres i gavatxs » (« dehors les voleurs et les gabelous ! ») ou « a carn, a carn » (« à la chair, à la chair ») étaient certaines des expressions les plus récurrentes16. Logiquement, les cris et les dénonciations de la population avaient pour objectif les Français et, plus précisément, les soldats et les collecteurs de l'impôt. De fait, la majorité des acteurs des soulèvements locaux faisaient partie du corps villageois, malgré la présence de quelques nobles roussillonnais. Les intégrants par secteurs de la révolte furent : des muletiers (les premiers affectés et aussi les premiers suspects de la révolte pour les autorités) ; des clavataires (travailleurs des forges et des martinets), qui prirent le leadership de la révolte (il s'agissait d'un groupe cohérent et solidaire, qui travaillait côte à côte, et avait donc une certaine conscience collective, en plus, même s'ils avaient moins de contact avec les soldats, les clavataires pouvaient cristalliser leurs idées dans les forges et ainsi passer à l'action) ; des paysans (ils ne formaient pas un groupe homogène, mais intervenaient beaucoup individuellement) ; des femmes (un groupe souvent oublié par sa transparence, mais qui intervint passivement dans la révolte) ; et, pour finir, des enfants et adolescents (ils eurent un rôle important, car les soldats se méfiaient peu d'eux). Finalement, surprend le nombre relativement petit de participants à la révolte et comment ils furent capables de pouvoir mettre en doute l'autorité de la France dans le Vallespir. Il est clair que, sans le soutien populaire — actif et passif —, cela n'aurait pas été possible. Et c'est que la lutte était générale et une affaire de tous. La relation du conflit avec la guerre devient clé, comme le sont aussi les effets contre-identitaires sur la population. La France voyait un danger réel dans la révolte, comme le démontrent les réactions que nous avons vues avoir eu lieu, même si dans un premier moment ils laissèrent que ce soient leurs compatriotes du Conseil Souverain qui s'en chargent. Le débat historiographique se centre sur la nature réelle de la révolte : antifiscale ou nationale. Ce fut Philippe Torreilles qui récupéra la mémoire historique de la Révolte des Angelets au début du XXe siècle. Depuis lors, cette histoire cessa d'être un thème strictement populaire pour être débattu dans le domaine des études historiques. Il a beaucoup plu depuis lors et les interprétations ont abandonné leur caractère légendaire. Malgré tout, celle-ci continue d'être une révolte presque inconnue ou omise par l'historiographie française. Une chose est sûre : l'extension et la durée du conflit solidifièrent une idéologie trop éparse et qui ne peut avoir une lecture isolée et locale, mais doit être incluse dans le long conflit franco-espagnol et dans la continuation d'un sentiment antifrançais qui existait dans les comtés depuis bien avant que dans d'autres zones géographiques de Catalogne. Cela ne veut pas dire, donc, que ce fut la représentation d'une construction mentale et nationale, mais bien l'expression de l'identité propre face à l'autre qui est rejetée. Le cas du Roussillon pouvait faire craindre, effectivement, que la révolte ne se convertît en une révolution — une séparation — contre la France. De cette manière, nous entendons que l'envoi de grands contingents militaires dans les zones les plus conflictuelles peut s'expliquer comme une volonté pour en finir avec une révolte qui avait été interprétée comme quelque chose de plus qu'une révolte antifiscale. De fait, la durée et la consistance de la rébellion provoquèrent une méfiance à long terme des autorités françaises envers les populations de la frontière pyrénéenne. Le mouvement armé des Angelets créa un précédent capital dans les relations entre les Roussillonnais et les Français, au moment où la province fut annexée par la France, et marqua la mémoire tant des uns que des autres. De son côté, Alain Ayats considère que « la Révolte des Angelets ne posa pas de problèmes militaires sérieux ». Alors, nous pouvons nous poser deux questions : si réellement la France n'y vit aucun danger, comment se fait-il qu'on décida de développer avec urgence une frontière militaire aux Pyrénées durant les années soixante-dix ? Et, comment se fait-il que nous trouvions des documents, encore après la Guerre de Hollande, où les autorités françaises manifestent encore une grande méfiance envers les habitants des montagnes du Vallespir et expriment la nécessité d'un renforcement du contrôle pour ne pas retrouver une nouvelle révolte d'Angelets qui pourrait provoquer une sécession ? À la première question, Ayats lui-même y répond en disant que c'est à la suite de la révolte que les Français décidèrent de contrôler la frontière plus efficacement. Par conséquent, la révolte — nationale ou non — fit prendre conscience aux autorités françaises du danger qu'elle représentait par elle-même et par le lien qui pouvait s'établir avec les terres du sud36. Manifestement, l'identité antifrançaise de la révolte menait à un renforcement de l'identité locale ; un « fait local » qui pouvait devenir ample à mesure que le conflit avec le Français s'allongeait dans le temps et dans l'espace catalan. (texte de l'Òscar Jané Checa, 2004)
Au cri de « Via fora, lladres i gabatxs! » (« Dehors, les voleurs et les gabelous ! ») et « Visca la Terra » (« Vive la Terre »), des groupes armés s'organisent partout sur le territoire, les Catalans sont un peuple habitué à l'usage des armes et expérimenté dans la guerre de guérilla. Les Angelets de la Terra sont un corps armé, organisé techniquement et tactiquement suivant les systèmes habituels d'autodéfense du pays, comme les sometents (levées en masse), miquelets, etc. Ils connaissent très bien le terrain, beaucoup d'entre eux sont des muletiers du sel, ils jouissent d'un soutien populaire et savent tirer parti de l'armement léger avec platine à silex et de la liberté de mouvements que leur donne le fait de ne pas combattre comme une armée réglée. Dans cette image, nous montrons différents types de combattants, depuis les chefs militaires de différents niveaux jusqu'aux combattants de base et les armes qui leur étaient propres. Un fait singulier est qu'en tant que signe distinctif, ils portaient un vêtement de couleur bleue dite "blauet", que ce soit une plume, les chausses, des chaussettes, la ceinture, la barretina (bonnet) ou la cape. Ils libèrent des populations entières (Prats-de-Mollo, Arles, Céret, etc.) et provoquent beaucoup de pertes parmi les troupes françaises et les gabelous (collecteurs de l'impôt) et en 1669, le compromis de Céret, par lequel les fonctionnaires du sel ne feraient plus d'inspections et s'entendraient avec les Conseils de chaque village pour la vente du sel. Mais les autorités ne respectent pas le même traitement avec le reste des territoires et la révolte devient encore plus cruelle. Les Angelets interviennent dans la conspiration de Villefranche-de-Conflent (1674) pour atteindre la réunification de la Principauté. Malheureusement, la conspiration est découverte. La répression s'étend à toute la population jusqu'à un paroxysme insupportable aussi pour la monarchie française qui arrive à offrir au roi des Espagnes une révision du Traité des Pyrénées, Louis XIV propose insistant (entre 1668 à 1677) d'échanger les comtés catalans contre la Flandre. Josep de la Trinxeria est le commandant des Angelets. Membre d'une famille de bourgeois, paraires (drapiers), et notaires de Prats-de-Mollo et, avant 1640, avec divers droits royaux et propriétés en Garrotxa et dans le Vallespir, il consacra sa vie à lutter héroïquement pour la réunification de la Principauté. Il jouit d'un grand prestige parmi la population et est l'un des promoteurs de la conspiration de Villefranche-de-Conflent. Il meurt au combat en 1689 durant l'une de leurs habituelles incursions dans les territoires de la Catalogne Nord pour harceler les occupants français qu'il organisait depuis sa base opérationnelle à Olot, où il était réfugié depuis 1674. En faisant une analyse stylistique des deux peintures, on voit clairement qu'elles furent l'œuvre du même peintre. La date de réalisation, en nous basant sur la structure formelle du vêtement des deux personnages qui, soit dit en passant, sont identiques, nous permet d'assurer qu'elle est propre au moment de la commande, ils suivaient la mode de 1726, trente-sept ans après la mort de Josep, entre-temps il a un peu plu, ont passé la guerre de la Ligue d'Augsbourg (Guerre des Neuf Ans), la Guerre de Succession d'Espagne, la défaite de 1714, l'avènement des Bourbons et les décrets de Nueva Planta. Pour arriver à cette conclusion, il suffit de se centrer sur la pièce principale du vêtement qu'est la casaque, à revers avec la boutonnière distribuée deux par deux, avec le revers de la manche jusqu'à la hauteur du coude et la disposition de la boutonnière de la poche. Conclusion, le vêtement que porte Josep de la Trinxeria qui a vécu entre 1630 et 1689 nous dit clairement qu'il n'a rien à voir avec ce qu'il aurait pu porter à un moment de sa vie et moins encore durant la révolte des Angelets. Malheureusement, ce fait n'a rien d'étrange comme on peut le constater dans d'autres collections de portraits familiaux, tous ceux qui représentent des personnages antérieurs au moment de la commande ne sont jamais archaïsés et on ne fait pas la moindre recherche documentaire sur comment ils auraient pu être vêtus. Au plus, on peut y incorporer un détail qui était caractéristique de la personne, dans ce cas, nous oserions dire que ce pourrait être la moustache, retroussée vers le haut, que bien sûrement ses descendants se rappelaient de leur grand-père Josep. Le reste leur était indifférent. Josep de la Trinxeria comme il se doit – Restitution rigoureusePour la correcte recréation du personnage, nous nous sommes basés sur la description de son vêtement faite en 1673 et retrouvée par Alain Ayats dans son livre Les guerres de Josep de la Trinxeria, il dit : « portait un habit de drap foncé avec un galon d’argent et un chapeau à la française avec des houppes » complétée par les images de diverses sources iconographiques contemporaines qui aident à voir la structure formelle du vêtement et la manière de le porter. Cela correspond au niveau social aisé selon la biographie du personnage. Il porte les cheveux longs suivant la coutume du moment, la moustache retroussée vers le haut respectant le tableau familial. Casaque jusqu'à mi-mollet (l'habit) avec les manches ouvertes laissant voir la chemise, galonnée sur les bords et coutures. Boutonnière sur le devant. À la ceinture, une courroie avec la double finalité d'être ornementale et fonctionnelle pour y porter l'armement. Une cape sur l'épaule gauche qui, suivant le style de l'époque, lui enveloppe la main droite avec laquelle il tient le chapeau à la française. Chausses du même drap, serrées, fermées avec des rubans et des brodequins hauts avec des garde-pieds. Les bottes portent le garde-pied qui fixe l'éperon quand il est à cheval. Armé d'une épée à garde de coquille pendue à un baudrier de cuir, un pistolet de 3 pans (env. 60 cm) et un autre court avec sa correspondante sacoche pour les pierres et les balles ainsi qu'un flacon avec doseur pour porter la poudre. Durant la guerre entre la France et la Hollande, la monarchie hispanique fut alliée du Saint Empire, raison pour laquelle elle facilita l'asile de Josep de la Trinxeria qui reçut une patente de colonel de Miquelets. Pour ne pas rendre ce texte plus long, nous avons omis les détails héroïques des faits d'armes de ceux qui furent considérés comme les derniers défenseurs des libertés catalanes en Catalogne Nord et sacrifièrent leur vie pour défaire le démembrement de la Principauté. Ce serait quelque chose de tout à fait impardonnable qu'ils restent dans l'oubli, ne trouvez-vous pas ?
Resultat de la recherche
: {{ itemarecherchesauvegarde }}


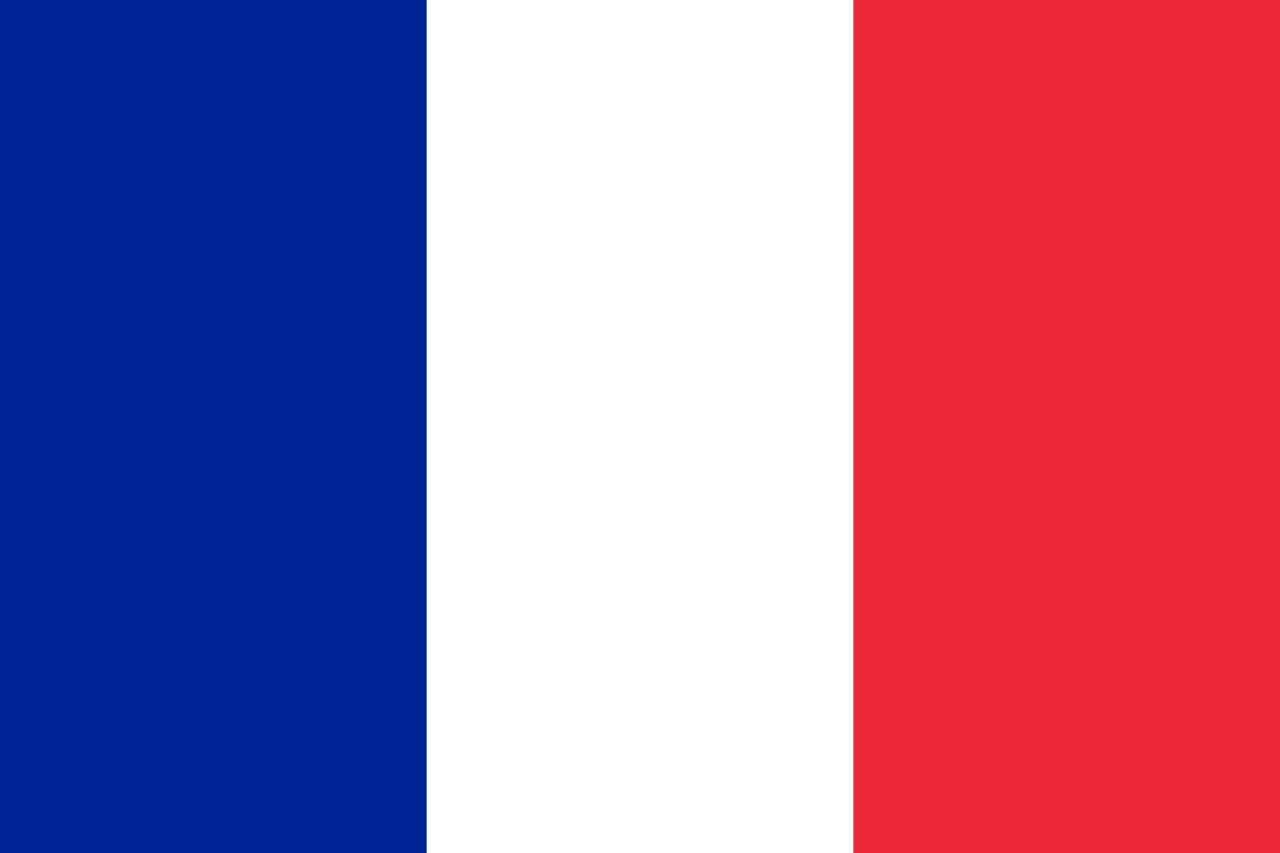 FR
FR
 CAT
CAT